-
L'enseignement privé sous contrat | Cour des comptes
Tue Aug 26 16:11:04 2025 - permalink - - https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lenseignement-prive-sous-contrat+ https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2423_rapport-information (avril 2024)
En 2024-2025, ce sujet a bien moussé dans les médias et dans l'opinion (déclaration de la ministre de l'éduc' nat', Bétharram, etc.). J'attendais que ça retombe un peu pour regarder le factuel.
- En 2021, environ 17 % des élèves du premier et du second degré étaient scolarisés dans des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État. Stable depuis les années 60. Environ 0,7 % des élèves étaient scolarisés dans l'enseignement privé hors contrat. L'instruction en famille représentait environ 0,4 % des gosses soumis à l'obligation d'instruction (source). (Division par 2 en 2024-2025 suite à l'instauration de l'autorisation préalable.) Ce qui nous fait environ 82 % des lardons dans le public.
- En 2021, l'enseignement privé catho sous contrat représentait environ 96 % des élèves scolarisés dans le privé sous contrat.
- En 2021-2022, les établissements privés sous contrat étaient financés à environ 75-78 % par la puissance publique. Pas une spécificité française. À 55 % environ par l'État pour le 1er degré, à environ 68 % pour le second degré, pour un total d'environ 8,5 milliards d'euros en 2022. Le reste, c'était les collectivités territoriales, dont les régions, pour un total d'environ 2 milliards d'euros en 2022. En comparaison, les établissements publics étaient financés par l'État à environ 59 % (1er degré) et environ 74 % (second degré).
- En 2021, environ 12 % des élèves du privé sous contrat étaient boursiers contre environ 29 % dans le public. En mai 2023, le ministre de l'éduc nat' Ndiaye a invité les établissements privés à doubler leur effectif de boursier sous 5 ans.
- Les établissements privés sous contrat accueillent de moins en moins les élèves des milieux défavorisés (= ouvriers et inactifs). En 2000, 25 % de leurs élèves étaient des gosses de défavorisés, 16 % en 2021 (contre 40 % => 37 % dans le public). En 2000, 41,5 % de leurs élèves étaient des favorisés ou très favorisés (= professions intermédiaires, cadres, chefs d'entreprise, professeurs), 55,4 % en 2021 (stable à 32 % dans le public). Pas de chiffres pour la classe moyenne (= employés, agriculteurs, artisans, commerçants… qui représente pourtant le tiers restant.
- Spécificité française : quasiment aucune contrepartie contraignante en matière de mixité sociale ne pèse sur les établissements privés.
- Je pensais que, dans le public, les gosses de défavorisés sont parqués dans les établissements d'éducation prioritaire, ce qui relativise la mixité. Je me trompais. En 2021, les gosses de défavorisés représentaient 37,2 % des élèves du public (en général) contre 34,5 % des élèves du public hors éducation prioritaire. Écart de trois points constant depuis 2000.
- En réaction à la ministre Oudéa-Castéra qui avait déclaré avoir choisi l'école privée pour ses rejetons à cause du « paquet d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées », le Canard enchaîné du 17/01/2024 a répliqué par la formation continue des enseignants programmée par le ministère sur les heures de cours, sans remplacement. Or, la Cour des comptes évoque 3 h/an de formation en moyenne dans le public. Donc ce n'est pas ça. De plus, l'ensemble des fonctionnaires a été absent 12 jours en moyenne en 2023 contre 10 jours pour l'ensemble du privé. Forte disparité, stable depuis au moins 10 ans, entre FPE (9 jours) d'une part et FPT et FPH (14-15 jours) d'autre part. La disparité public/privé est expliquée par le fait que la fonction publique emploie davantage de seniors et de femmes que le privé. Source, page 166.
- En 2021, environ 17 % des élèves du premier et du second degré étaient scolarisés dans des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État. Stable depuis les années 60. Environ 0,7 % des élèves étaient scolarisés dans l'enseignement privé hors contrat. L'instruction en famille représentait environ 0,4 % des gosses soumis à l'obligation d'instruction (source). (Division par 2 en 2024-2025 suite à l'instauration de l'autorisation préalable.) Ce qui nous fait environ 82 % des lardons dans le public.
-
[ Limite à « l'indignation crée le sujet » ? ]
Fri Oct 6 20:14:28 2023 - permalink - - https://nitter.privacydev.net/malopedia/status/1410619754285441029#mVOUS ME SAOULEZ avec la vidéo de la députée LR qui veut interdire les danses aux mariages : vous êtes des gros débiles. Ils proposent n'importe quoi qui a 0 chance de passer, vous vous indignez comme des robots, et hop ce sujet envahit le débat public... Et la députée (que je ne nomme volontairement pas) ? Elle est ravie, mission accomplie : jusque là elle n'était connue que pour ne pas savoir tenir l'hémicycle quand elle préside, maintenant elle va avoir a une petite aura médiatique de droitarde et son entrée sur les plateaux.
[…]
"Oui, mais ça aurait pu être voté". Non. Désolé de me la jouer expert, mais j'ai un accès permanent à l'hémicycle : je sais comment marche ce jeu. Alors faites confiance aux gens comme moi : on vous prévient quand il y a vraiment danger et qu'il faut monter au créneau.
[…]
Surtout qu'au final, vous allez effectivement finir par transformer ça en truc voté. Exemple ? La proposition de loi Ciotti qui interdisait de filmer les flics : elle allait faire un flop total si personne ne l'avait relevée... Sauf que vous vous êtes tous indignés en pilotes automatiques, en face ils ont vu que ça mordait, ça a fait le tour des plateaux, résultat, 6 mois plus tard, elle se retrouvait dans la loi sécurité globale. Super vous vous êtes indignés, mais vous êtes contents du résultat ?
[…]
on fait pas bien de la politique si on refuse de penser stratégiquement.
[…]
Précision qui semble échapper à beaucoup : une députée LR n'est PAS l'Etat français, et n'est PAS son représentant. […] Quand c'est Macron ou un ministre qui tient ces discours (Blanquer, Vidal, Darmanin), là, il me semble que la réaction est importante, parce que ce n'est pas du tout la même chose.Je suis d'accord pour dire que c'est l'indignation qui fait crée et fait circuler les sujets et que les propositions de lois ont très souvent un but médiatique. Mais…
Faire confiance aux experts, c'est non. Comment déterminer qui est expert ? LQDN ou Greenpeace, par ex., hurlent quasiment à chaque fois (exemple). Comment faire la part des choses (sauf à étudier soi-même chaque cas en détail) ? Comment dénoncer un comportement déplaisant d'élu sans citer d'exemple ? Ça serait aux politiciens d'être raisonnables, calmes, responsables, etc.
Les propositions de loi "qui ont aucune chance de passer" sont des ballons d'essai, parfois poussés par le gouvernement, pour discuter de la faisabilité, pour récupérer les premiers contre-arguments pour étude, pour repérer les premiers soutiens, etc. et les idées de merde ne meurent jamais. Ça n'a rien à voir avec la publicité d'une idée. Même sans bruit médiatique, le point serait gagné. Y'a qu'à voir l'historique de l'instruction en famille… Toutes les lois que j'ai suivi ont eu une phase de maturation par des propositions de loi et/ou des amendements rejetés.
Prétendre que c'est uniquement l'audimat qui transforme une idée absurde en loi est réducteur. La loi renseignement (2015), la loi séparatisme (2021), et autres lois ayant rencontrées une vive opposition argumentée ont été votées grâce à l'indignation, du coup ?
-
L'instruction en famille depuis 2013
Fri Sep 1 12:10:36 2023 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?UbykmADepuis la loi 2021-1109 dite séparatisme de 2021, l'instruction en famille (IEF) est conditionnée à une autorisation préalable (une dérogation) justifiée par un handicap / état de santé, la pratique intensive sport / arts, l'itinérance / l'éloignement géographique d'une école ou la situation propre de l'enfant et le projet éducatif.
Le Conseil constitutionnel a validé. L'IEF n'est qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction, ce n'est pas un droit, donc il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'enseignement. L'autorisation est conditionnée, entre autres, à la « capacité d'instruire » des parents et à un « projet pédagogique », donc intérêt général, pas de discrimination, etc., donc c'est OK. Ce faisant, il met l'IEF sous la tutelle de l'administration qui devra préciser les modalités de délivrance et de contrôle. Le Conseil d'État a validé les décrets, donc lesdites modalités (d'autres arguments pourront être tentés, bien entendu).
Mediapart nous informe que des rectorats refusent les dérogations (et donc l'IEF). De ma lorgnette (j'ai été à l'école publique), on me dit qu'il y a des académies mal lunées et des refus arbitraires un peu partout. La FÉLICIA rapporte le taux de refus national publié par le ministère : 53 %, à comparer avec le taux de contrôles positifs de l'IEF des années antérieures : 98 % (c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à signaler à l'issue de 98 % des contrôles). Selon une enquête maison de FÉLICIA, dans 85 % des refus, c'est la situation propre de l'enfant motivant le projet éducatif qui est rejetée (attention : faible échantillon, d'où la répartition par académie n'est pas publiée). Sans surprise : vu que c'était la seule marge de manœuvre prévue par la loi, c'est ici que l'État allait cogner.
Pour rappel, l'IEF est une obsession politicienne depuis fin 2013 : droite sénatoriale en 2013, droite de l'Assemblée en 2016 puis gouvernement de "gauche" en 2016. L'idée était déjà d'interdire l'IEF sauf incapacité constatée puis de renforcer les contrôles, notamment en en différenciant les modalités par rapport aux écoles privées et publiques (notamment, la compétence des parents était exigée). Sur la période 2016-2018, les écoles privées sans contrat avec l'Éduc' nat' ont aussi fait l'objet d'un serrage de vis parce que "oulalala les musulmans" (on fermera bien sûr les yeux sur les écoles cathos intégristes).
Via https://cakeozolives.com/shaarli-antichesse/?rkzRUw et https://cakeozolives.com/shaarli-animal/?kuhZlw.
-
Dans le Canard enchaîné du 5 mai 2021
Tue Jan 25 20:08:22 2022 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?SpyCrg- On dit souvent que Macron a fracturé la droite et la gauche. Dans un cas précis qu'il a « piloté », le rapprochement entre LRM et Muselier aux régionales 2021, Macron le reconnaît : « il faut suivre de près ce désordre à droite et la fracture qui s'amplifie, ce qui était quand même notre objectif principal » ;
- Lors des différents débats législatifs 2014-2018 pour renforcer les contrôles autour de l'instruction en famille (IEF) et limiter le recours à d'autres formes d'instruction que l'éduc' nat', les parlementaires expliquaient aux opposants, qu'un des objectifs était de lutter contre le mézant pas beau communautarisme musulman, la désinformation et l'enfermement des gamins par leurs familles. Le Canard a lu des manuels scolaires rédigés par des dominicaines enseignantes de Brignoles, une congrégation catho intégriste et destinés à 58 écoles proches de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X hors contrat de l'Éduc' nat'. Chaque référence à la Résistance y est entourée de guillemets. « Les auteurs de ces provocations étaient toujours des militants communistes éprouvés (…) de véritables professionnels du meurtre et du sabotage ». Les collabos Déat, Darmand ou Doriot « profondément opposés au bolchevisme, agirent souvent avec imprudence, toujours avec courage. Ils payèrent durement leurs erreurs à la Libération ». « les communistes avaient réussi à briser l'élan de la Révolution nationale ; l'insécurité et la violence détruisaient le climat de confiance ». Le procès de Pétain est un « montage sans honneur ni vérité ». L'épuration, qui aurait « frappé l'élite des Français » aurait « anéanti tout l'effort de redressement moral qui avait commencé en en 1940-194 et qui avait déjà donné du fruit ». L'extermination des Juifs a été « exploitée sans scrupules par les socialo-communistes et les démocrates-chrétiens ». Comme quoi, sans surprise, on trouve aussi des mensonges, des approximations et des dogmes (France éternelle défendue par Maurras / Pétain) chez les cathos intégristes mais ils n'étaient pas mentionnés en permanence à demi-mots dans les débats parlementaires, eux ;
- En juillet 2018, la Cour de Justice de l'UE a jugé que la directive européenne sur les OGM s'applique aux NBT (New Breeding Technologies, nouvelles techniques d'édition du génome des plantes dont CRISPR-Cas9 est la plus connue). Par conséquence, le 7 février 2021, le Conseil d'État (qui avait interrogé la CJUE) a jugé que les NBT sont soumises à la réglementation française sur les OGM (évaluation des risques sanitaires, déclaration des cultures, avertir le consommateur sur l'étiquette, etc.). La Commission européenne envisage de réviser la directive européenne sur les OGM afin d'en exclure les NBT.
- On dit souvent que Macron a fracturé la droite et la gauche. Dans un cas précis qu'il a « piloté », le rapprochement entre LRM et Muselier aux régionales 2021, Macron le reconnaît : « il faut suivre de près ce désordre à droite et la fracture qui s'amplifie, ce qui était quand même notre objectif principal » ;
-
Une école où les enfants font ce qu'ils veulent - YouTube
Sun Jan 6 14:21:04 2019 - permalink - - https://www.youtube.com/watch?v=T9sK14MVDNsEncore une vidéo qui traîne depuis un an dans un onglet de mon navigateur web…
Une vidéo sur les écoles démocratiques. Ce sont des écoles privées sans contrat avec l'Éducation nationale, ce qui veut dire que les enseignants (il n'y en a pas) n'ont pas une formation reconnue par l'État, ne sont pas rémunérés par l'État, que le programme (il n'y en a pas non plus) n'est pas validé par l'Éducation Nationale, etc. C'est parfaitement légal : en France, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est, peu importe la forme qu'elle prend. Pour les détails, notamment sur les différents types d'écoles, voir mon shaarli sur le sujet.
Dans ces écoles, il n'y a pas de notion d'adulte et d'enfant avec le sous-entendu que l'enfant est irresponsable, qu'il n'est qu'une ébauche d'adulte, donc que seule l'autorité de l'adulte prévaut. Ce renversement de ce prétendu état de fait majoritaire est très bien exprimé dans l'ouvrage de Catherine Baker (lire le 4e point en partant de la fin). De là découle la participation de tous les membres à la prise des décisions (y compris ce qui touche au financement, à la survie de l'école ? La vidéo ne le dit pas), notamment à l'élaboration du règlement intérieur qui fixe les règles du vivre ensemble, ainsi qu'à l'énonciation de sanctions (l'école est dotée d'un conseil de justice qui prononce des rappels au règlement dont les membres sont représentatifs, en âge, des enfants). Les membres de l'école ne font donc pas « ce qu'ils veulent », comme le résume mal le titre putaclic de cette vidéo.
En revanche, sur le plan pédagogique, les membres de l'école jouissent d'une liberté totale : il n'y a pas de cours à heure fixe, pas de prétendu sachant-tout qui délivre son unique savoir bien-pensant à des prétendus ignorants-tout, pas d'activités communes programmées, et personne est autorisé à forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Les membres apprennent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au rythme qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent, en présence des personnes de leur choix. Quelques-unes des activités montrées ou exprimées dans la vidéo : lecture de BD, montage vidéo, piano, synthé, dessin, jeux de société, jeux vidéos, etc.
La motivation pour lire, écrire, compter, etc. naît d'un besoin, tout comme parler, manger proprement, s'habiller tout seul, etc. Si l'on ne bride pas sa curiosité, chaque membre de l'école se conduira de lui-même vers ces activités, mais à un rythme différent, non imposé. Les membres encadrants, qui n'ont pas de formation, ont pour rôle de guider les autres membres vers des ressources et des personnes afin qu'ils y trouvent les informations dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet personnel.
Quand on évoque l'instruction en famille, notamment avec nos élus, les personnes sont effrayées : ils imaginent des enfants enfermés au domicile de leurs parents, prisonniers de leurs parents, prisonniers des idéologies ‒ forcément islamiques sinon ça ne fait pas peur ‒ de la famille, isolés, qui ne se sociabilisent pas, qui ne fréquentent pas d'autres enfants de leurs âges, qui n'apprennent pas la vie en société (tu sais, la fameuse « violence de la cour de récréation » qui crée des adultes névrosés), et dont l'apprentissage est à la merci du temps que peuvent leur consacrer leurs parents. Il n'y a rien de plus faux, mais les préjugés ont la peau dure. Ces écoles ont le mérite de casser ce mythe : les membres doivent apprendre à vivre ensemble, comme à l'école publique. Ce qui m'intéresse, c'est de mesurer si ces écoles diffusent moins de violences, si les citoyens qu'elle forme sont moins névrosés que ceux de l'école publique, etc. J'aimerai que des recherches soient menées sur ce sujet précis, le seul qui compte.
J'espère que tu comprends mieux, lecteur, que le désir des politiciens de tous poils de contrôler toujours plus fermement les écoles privées hors contrat au motif d'un prétendu enfermement communautaire islamique vise aussi ces écoles-là. Les lois qui visent à renforcer le contrôle sur l'instruction en famille et les écoles prétendument islamiques radicales porteront également atteinte aux écoles démocratiques, car la loi ne les différencie pas, elles sont toutes deux désignées par l'étiquette « école privée hors contrat ». Voilà une des raisons pour lesquelles je me suis toujours opposé à ces serrages de vis (l'autre étant que la montée du communautarisme religieux est une fable inventée par les politiciens afin de servir leurs sombres desseins) et que je t'invite vivement à faire de même.
-
Insoumission à l'école obligatoire - Catherine Baker - éditions tahin party
Sun Oct 22 14:27:02 2017 - permalink - - http://tahin-party.org/cbaker.htmlJe suis radicalement opposé à l'école (que ce soit celles de l'éduc' nat' ou celles sous contrat ou celles hors contrat) depuis ma scolarité. À la fin de la version papier du guide d'autodéfense numérique, dans la section « du même éditeur », ce livre de Catherine Baker était référencé. Je m'étais dis que ça serait cool de lire ce que d'autres ont écrit afin de formaliser et affûter mes arguments anti-école.
Entre temps, j'ai lu le livre-recueil de quelques écrits d'Aaron Swartz (mes notes) dont certains ont l'école comme sujet. Ce dernier se concentre sur les faits historiques pour illustrer que l'école a été conçue, au moins aux États-Unis, comme un moyen de contrôle social au service du patronat. Il effleure aussi la psychologie pour expliquer l'échec de l'école à instruire depuis 2 siècles ainsi que la volonté implicite de domination de celle-ci.
Dans ce livre, l'auteure étudie le sujet sous les angles de la philosophie, de la morale et de la psychologie. Elle nous y parle de l'école comme lieu de maintien du Système, comme d'un empêchement de l'enfant de réfléchir au monde qui l'entoure et de se construire (ce qui en fera un⋅e citoyen⋅ne passif⋅ve). Tout comme Aaron, elle expose la violence de l'école (domination, humiliation, etc.). Elle réfute les arguments pro-école classiquee "l’école n’est plus comme ça de nos jours !" et "il n'y a pas d'uniformisation puisque il y a la liberté de l'enseignant⋅e". Au final, l'auteur⋅e explique que l'enfant est un adulte à part entière et qu'il ne faudrait pas le considérer comme un être diminué, donc il faut lui reconnaître sa capacité de réflexion, sa liberté totale, sa possibilité de travailler et de baiser, etc. ainsi que de participer aux choix qui construisent son environnement. Ce livre et les écrits d'Aaron sont complémentaires.
Ce qui manque à ce livre, c'est un contrepoint : ni l'école, ni l'instruction en famille ne sont parfaites, mais l'auteure s'acharne uniquement sur la première. Dans certains chapitres, l'auteure semble réfuter implicitement l'autorité (parfois sous la forme de manipulation pour tromper l’enfant dans ses choix afin de le conduire à faire ce que l'on veut) et la reproduction sociale qui sévit dans certaines (toutes ?) familles. L’auteure n’écrit pas un mot sur le fait que tout le monde n'a pas le temps d'instruire son enfant. De même, tout le monde ne sait pas instruire sans forcer ni vivre en groupe (famille) sans imposer à l'autre. Je n'ose pas croire que la vie des instruit⋅e⋅s en famille est aussi idyllique que celle décrite par l'auteure ("je ne t'ai jamais rien ordonné, on a toujours discuté, sauf une fois où je ne voulais pas que tu achètes des boucles d'oreille", "tu décides librement de tout, d'ailleurs tu vas te coucher bien après moi depuis tes 4 ans").
Le style littéraire (l'auteure s'adresse à sa fille à travers ce livre) rend certaines pages vraiment pénibles à lire, mais on les repère vite (début/fin de chapitre, par exemple), donc on peut les ignorer. En effet, l'auteure en fait parfois des tonnes sur les dommages que provoquerait l'école sur les enfants et sur les (ir)responsabilités qu'on lui prêtera concernant la non-scolarisation de sa fille. Mais, d'un côté, je comprends cette forte externalisation des sentiments… Après tout, je suis celui qui a écrit, dans un courrier à des élu⋅e⋅s, que « l'école de la République [est] une machine à échecs qui broie des âmes. » et qui assume ces propos. Mais je comprends qu’ils puissent faire peur en apparaissant « too much ».
Je recommande vivement la lecture de ce livre.
Quelques notes :- L'auteure s'oppose à toute forme d'éducation et de journalisme : la transmission des savoirs devrait seulement se faire en discutant de gré à gré entre personnes égales. Sinon, le rapport de force ne permet pas la remise en question ("tu exagères" "tu as mal interprété", "tu te trompes", "tu oublies de mettre en perspective"), ce qui est possible dans un rapport entre pairs ;
- L'école est un investissement pour que l'enfant obtienne un rang dans la société productiviste. Ce rang dépend d'un diplôme donc d'un examen qui est en fait un contrôle de conformité de l'individu : on choisit ce qui est utile à la société. Jadis on apprenait le tricot ou la mécanique, aujourd'hui, c'est l'informatique. Il s'agit aussi de transmettre de la morale afin que la société ne s'effondre pas : l'amour de la patrie en 1913, la rentabilité de nos jours (d'où le système de compétition à laquelle ;) ). Jules Ferry (si, si !) disait que l'État s'occupe de l'éducation « pour y maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation ». Ce n'est donc pas une erreur, l'éducation nationale n'a pas déviée, elle a été conçue comme cela ;
- La crèche libère les femmes afin qu'elles puissent retourner travailler. Il en va de même pour l'école. Là encore, l'école est un mécanisme pour améliorer la productivité nationale ;
-
Partout, on enseigne de gré ou de force « pour le bien de l'humanité ». Partout, tu trouveras sous toutes les latitudes, les mêmes règles scolaires : on te fait entrer dans le troupeau des gens nés la même année que toi, on t'oblige à écouter quelqu'un, ce quelqu'un que tu n'as pas choisi et qui ne t'a pas choisie est payé pour te mettre, quels qu'en soient les moyens, certaines choses dans le crâne, lesquelles choses sont choisies par les États qui, en fin de course, sélectionnent par les diplômes la place qu'ils t'assignent dans leur société. Ton espace est aussi clôturé que ton temps : tu ne peux participer d'aucune manière à la vie de ceux qui ne sont pas en âge d'être scolairement conscrits.
- En réalité, l'école est là pour apprendre aux enfants l'autorité, l'oppression, l'obéissance. Apprendre à aire plaisir au maître, puis au prof puis aux parents en montrant son intérêt et en ayant de bonnes notes. Apprendre à se taire, apprendre la servitude (exemple : pour aller aux toilettes, il faut demander la permission… et parfois s'entendre répondre « D'accord, mais en revenant, tu me récites la table de sept, t'avais qu'à prendre tes précautions ! » [ Note : je suis content d'apprendre que je ne suis pas la seule personne au monde à avoir subit ça ! ]). Bref, on apprend ce dont la société a besoin pour se maintenir ;
-
Libérale ou non, l'école postule l'inachèvement de la jeunesse. Elle doit avoir une action « maturante ». Bien sûr, me dit-on, que les fruits de toute façon mûriront, mais ils seront plus beaux si on a mis de l'engrais aux arbres ! Peut-être, mais vos fruits n'ont plus de goût.
- L'auteure met le doigt sur le fait que les adultes qui défendent l'école obligatoire bec et ongle sont ceux et celles pour qui l'école s'est plutôt bien passée et leur a apporté une position décente dans la société. De même, si l'école s'est plutôt mal passée, mais que la personne a obtenu un rôle décent dans la société, elle considérera que l'école a été un investissement douloureux, mais qu'il en valait la peine. En gros, ceux et celles qui défendent l'école utilisent le même procédé cognitif que les personnes qui défendent un monde libéral sur le plan économique et conservateur sur le reste : ils et elles savent que ce modèle détruit des gens, mais, boarf, qu'est-ce que ça peut faire puisque ce modèle leur a environ bien réussi ? Tu parles d'un argument… ;
-
Il faut garder la jeunesse du vrai savoir (alors on lui donne du savoir « placebo » pour canaliser ses curiosités) afin qu'elle ne rivalise avec ses aînés que sur des sujets sans grand intérêt.
- L'Éducation nationale croit tout faire pour la réussite des enfants avec ses redoublements, son collège unique, ses filières adaptées, etc. Donc, si t'échoues, c'est que t'es mauvais. On intériorise l'échec donc on fait naître de l’agressivité ;
- Quand on critique négativement l'école, on s'entend répondre que l'école a bien changé depuis le temps où on y était. En lisant ce livre, on comprend que les grandes lignes et les petits exemples (comme la sanction pour la pause pipi impromptue) n'ont pas changé entre les années 50-60 (scolarisation de l'auteure), les années 1970-1980 (là d'où elle tire ses exemples actualisés), et 1990-2000 (ma scolarité). De plus, oui, on était heureux à l'école, c'est vrai. La satisfaction d'être bien noté est le meilleur moyen dont dispose l'école pour éviter les remises en question de ses méthodes, de son utilité et de son fondement : rien ne fait plus plaisir un⋅e humain⋅e que de satisfaire un⋅e autre humain⋅e. Ainsi, en apprenant, en faisant la pute auprès du prof (comme l'écrit l'auteure), en ayant de bonnes notes, on se récompensait nous-mêmes à travers la satisfaction du corps enseignant. C'est ce qu'on nomme la soumission consentie, très répandue dans notre société ;
- Le deuxième retour de flammes, quand on critique négativement l'école est que si l'école uniformisait autant de cela, comment se fait-il que lui aime ceci et cela et suit tel courant de pensée alors qu'elle aime cela et ceci et suit tel autre courant de pensée sur un même sujet. [Foucault]( a déjà répondu à tout ça : le système s'en fiche qu'ils y ait quelques profs qui sortent un poil des sentiers battus, qui présentent des choses que le programme ne prévoit pas ou qui disent quelques vérités, car le système n'a pas besoin d'une uniformisation complète, sinon elle se fait démasquée et devient inutile, mais il a besoin d'une soumission à des schémas généraux. Donc, l'école uniformise tout en conservant les singularités nécessaires et suffisante à l'exercice et au maintien de son pouvoir et de celui du système. En revanche, les profs qui vont au-delà, qui tentent quelque chose de dangereux pour le maintien du système (comme ceux et celles qui refusent de noter leurs élèves, exemple choisi par l'auteure) sont mis au placard assez vite ;
- Les profs, comme tout le monde, sont victimes de l'effet Pygmalion : si quelqu'un croit qu'une personne possède une qualité que l'on recherche (intelligence ou facilité à apprendre des pavés, par exemple), ce quelqu'un changera son attitude et permettra ainsi à la personne de développer la qualité rechercher. Cela signifie donc qu'il faut disposer d'un préjugé favorable de la part du prof si l'on espère progresser… ;
- On occupe un enfant comme on occupe un pays, pour que ni l'un ni l'autre ne fasse chier le pauvre monde, pour empêcher l'enfant de faire des bêtises, dit-on poliment ;
- D'une manière générale, l'auteure dénonce la domination de l'adulte sur l'enfant comme si l'adulte connaissait LA grande vérité et qu'il se devait d'y conduire l'enfant. Or, l'enfant n'est pas une embauche ni un projet d'adulte : il est un être total et présent à part entière. L'enfant, comme l'adulte est doté de raison, de volonté, de conscience, de culture, etc. Stop aux remarques déplacées des adultes que les enfants ne peuvent leur retourner par manque d'autorité (arrête de bouge ! mange ! etc.). Stop aux phrases comme « arrête de faire l’enfant ! ». L'enfant doit forcément participer aux choix qui construisent son environnement.
- Les enfants peuvent travailler. Le travail des enfants ne devraient pas être interdit. Leur exploitation doit l'être, tout comme pour les adultes. Pour éviter que les enfants de familles pauvres ne soient contraints de travailler et donc d'être exploités (puisqu'aucun contrôle n'empêchera l'exploitation étant donné que le rapport de force entre employeur et enfant sera totalement déséquilibré), on peut penser à une allocation individuelle à l'enfant, au salaire de base, etc.
- Réserver un comportement à une tranche d'âge prédéfini et nommer « régression » les personnes qui le pratique en dehors de cette norme est une idiotie : on ne retourne pas en arrière, on tire de notre expérience passée ce qui est le mieux pour notre avenir. « Si je joue ou que je fais un câlin « comme quand j'étais petite », c'est bien dans mon âge que je le fais, et c'est ma façon, consciente de tout ce qui s'est passée après mon enfance, de vivre au mieux la situation présente. ».
-
L'individualisation de chaque être ne mène pas à une solitude pire. Au contraire, seul l'être humain dégagé de son animalité sociale (de sa bêtise organisée) donne une chance à chacun de vivre dans un monde où peuvent enfin s'aimer des individus délivrés des mécanismes.
- L'auteure s'oppose à toute forme d'éducation et de journalisme : la transmission des savoirs devrait seulement se faire en discutant de gré à gré entre personnes égales. Sinon, le rapport de force ne permet pas la remise en question ("tu exagères" "tu as mal interprété", "tu te trompes", "tu oublies de mettre en perspective"), ce qui est possible dans un rapport entre pairs ;
-
La non-scolarisation vue par Aaron Swartz
Fri Jun 30 15:36:10 2017 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?TOFckwJ'ai très envie de partager trois très jolis écrits produits par Aaron Swartz à propos de l'instruction en famille (non-scolarisation). J'en recommande très vivement la lecture. C'est long et copieux mais très instructif.
En s'appuyant sur plusieurs sources, Aaron traite les principaux axes de cette thématique : les humain⋅e⋅s naissent avec la volonté d'expérimenter et de comprendre. Pourquoi, factuellement et historiquement, l'école n'est pas, par conception, un lieu d'apprentissage selon la méthode scientifique, mais un lieu de mémorisation forcée d'éléments pré-sélectionnés décorrélés du réel. En quoi les écoles sont des lieux de domination et de frayeurs. Factuellement, l'échec de l'école à instruire les gens date du 19e siècle. En quoi changer les méthodes d'enseignement ou la sémantique des questions des examens n'améliore pas les résultats. Pourquoi l'école, au moins aux USA, fut historiquement rendue obligatoire à des fins de formatage social et de contrôle social. En quoi la non-scolarisation est une des solutions crédibles et comment la mettre en œuvre.
J'ai extrait ces textes d'une version papier du livre « Celui qui pourrait changer le monde » grâce à un logiciel de reconnaissance des caractères donc il peut y avoir des fautes de reconnaissance qui m'ont échappées.
École
Texte d’une conférence donnée au Edmond J. Soho Center for Ethics à l’université Harvard au printemps 2011.
Dès leurs premiers instants sur Terre, les bébés s’ennuient.
Ils s’ennuient tellement, en fait, que c’est la base de toute la recherche moderne sur les bébés. Montrez trois points à un bébé (...) et il les fixera intensément pendant un moment, avant de s’ennuyer et de détourner le regard. Changez la position des points (. . .) et il les regardera un instant, avant de s’ennuyer à nouveau. Mais ajoutez un autre point (....) et il recommencera à les fixer avec intensité. Les scientifiques sont aux anges : les bébés savent compter ! Mais ils passent à côté d’une chose encore plus importante : les bébés s’ennuient.
Dans une autre étude, on a donné aux bébés un oreiller spécial pour qu’ils puissent ajuster la position de leur tête de façon à pouvoir contrôler le mouvement d’un mobile. Non seulement ces nouveau—nés apprirent rapidement comment faire bouger le mobile, mais cette découverte fut suivie de ce que les chercheurs appelèrent « des sourires et gazouillements énergiques » (référence : John S. Watson, « Smiling, Cooing, and « The Game » »). Comme l’a fait remarquer une étude ultérieure, « même en observant des nouveau-nés de façon informelle, on constate bien la joie qu’ils éprouvent à faire survenir des événements » (référence : Neal W. finkelstein and Craig T. Ramey, « Learning to Control the Environment in Infancy, Child Development, 1977, vol. XLVIII, p. 806—819). En d’autres termes, les nouveau—nés ne jouent pas simplement parce qu’ils s’ennuient — dès la naissance, ils connaissent le plaisir que procure le fait de comprendre les choses.
Et franchement, il est logique que les nouveau-nés veuillent comprendre les choses. Le monde est tellement déconcertant ! Il est rempli d’images, de sons et d’odeurs bizarres — un nouveau monde de goût et
de toucher. La seule façon de s’y retrouver est de s’y appliquer du mieux que l’on peut, d’observer toutes les nouvelles choses que l’on voit et d’essayer à tout prix de les comprendre.Donnez un nouveau jouet à un bébé de six mois et il l’« examinera de manière systématique avec tous les sens qu’il a à sa disposition (y compris le goût, bien sûr) », écrit une équipe de chercheurs de pointe sur les bébés. « À un an environ, ils introduiront de façon systématique des variations dans les actions qu’ils accomplissent sur un objet : ils pourront tapoter doucement contre le sol une petite voiture que l’on vient de leur donner, en écoutant les sons produits, puis ils essaieront de la frapper plus fort en faisant beaucoup de bruit, et ensuite de la frapper contre la surface molle du canapé. À 18 mois, si vous leur montrez un objet doté d’une quelconque propriété inattendue, comme une boîte avec un son de mugissement par exemple, ils essaieront systématiquement de voir si l’objet en question peut faire encore d’autres choses inattendues » (référence : The Scientist in the Crib).
Ils s’impliquent tellement dans tout ce qui constitue leur monde. Très vite, ils commencent à reconnaître les visages — à distinguer leur mère des autres personnes — et ce que signifient ces visages. Ils apprennent la physique des bébés — lorsqu’une voiture passe derrière un objet, ils savent exactement à quel moment la chercher du regard lorsqu’elle réapparaît de l’autre côté — et ils sont surpris lorsqu’elle surgit plus vite ou plus lentement que prévu. Ils écoutent ce qu’il se dit autour d’eux — le habillage que nous adoptons tous automatiquement en présence de tout—petits les aide à repérer les voyelles — et apprennent à imiter ces bruits pour eux-mêmes. En résumé, les tout-petits sont des machines à curiosité.
Lors d’une expérience, des chercheurs ont posé un jouet légèrement hors de portée de plusieurs bébés, à qui ils ont ensuite donné un râteau qu’ils pouvaient utiliser pour attraper le jouet. Au début, les enfants ont tendu la main vers l’objet, puis ils ont regardé leurs parents d’un air implorant pour qu’ils l’attrapent pour eux, mais ensuite ils se sont rapidement mis à chercher une manière de se débrouiller tout seuls » — et finalement ils ont compris qu’ils pouvaient utiliser le râteau pour arriver à leur fin. Leur visage s’est illuminé de cette joie que procure la trouvaille. Ils ont tendu le râteau devant eux, fait quelques essais maladroits, mais ont fini par attraper le jouet et le ramener vers eux.
Mais ce n’est pas tout — l’enjeu n’est pas seulement d’attraper le jouet. « Après une tentative ou deux, [ils] oublient complètement le jouet. Souvent, ils le jettent à nouveau très largement hors de leur portee et font des expériences avec le râteau pour le ramener vers eux. Le jouet en lui-même est loin d’être aussi intéressant que le fait que le râteau permette de le rapprocher. »
« Ce n’est pas simplement que nous, êtres humains, soyons capables de faire ça ; c’est plutôt que nous avons besoin de le faire, écrivent. les chercheurs. Il semble que nous ayons une espèce de pulsion explicat1ve, de même que nous avons une pulsion pour la nourriture ou pour le sexe. Lorsque nous sommes face à une énigme ou à un mystère, à un modèle qui semble se dessiner, à une chose que nous ne nous expliquons pas bien, nous l’examinons jusqu’à trouver une solution. En fait, nous nous confrontons volontairement à ce genre de problèmes, y compris aux plus triviaux, ceux qui nous divertissent de la peur des voyages en avion, que ce soit des mots croisés, des jeux vidéo ou des romans policiers. En tant que scientifiques, il nous arrive de veiller toute la nuit, pris par un problème, jusqu’à en oublier de manger, et je doute que nos salaires de misère soient notre unique motivation. »
Pensez aux expériences d’« environnement sécurisant » […] Lorsqu’ils se trouvent dans une situation étrange, les tout-pet1ts sont terrifiés — ils se cramponnent à leur mère pour chercher appui aupres d’elle. Mais très vite, leur curiosité leur fait donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils commencent, d’abord avec hésitation, mais bientôt très librement, à explorer le reste de la pièce. La pulsion explicative est tellement puissante qu’elle peut même vaincre la peur.
Et cela ne disparaît pas lorsqu’ils grandissent. Lors d’une expérience, on a présenté à des enfants de 4 à 10 ans une série de problèmes — certains faciles, d’autres plus ardus. Bien sûr, les enfants ne se sont pas attelés aux problèmes qui étaient trop durs pour eux, mais ils n’ont pas non plus choisi ceux qui étaient trop faciles. Ils ont cherché les problèmes qui leur correspondaient — ceux qui représentaient un défi, mais pas au point d’être impossibles à résoudre. Mais lorsqu’ils étaient recompensés — c’est-à-dire quand on leur donnait des récompenses pour avoir résolu des énigmes — ils retournaient directement aux problèmes les plus simples (référence : http://www.jstor.org/pss/1129110).
Quiconque a côtoyé des enfants d’âge préscolaire sait qu’ils n’ont pas besoin d’être motivés pour apprendre. « Il est rare que l’on entende « les parents se plaindre que leur enfant d’âge préscola1re « n’est pas motivé » », fait remarquer un psychologue pour enfants (référence : James Raffini 1993). En fait, les livres pour jeunes parents sont remplis de la plainte inverse : leurs enfants passent leur temps à leur demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. « Pourquoi on va dans la voiture ? », « Pourquoi on va au supermarché ? », « Pourquoi les gens utilisent de l’argent pour acheter des choses ? »
À vrai dire, cela en devient presque agaçant. Alors on les envoie à l’école.
Il est bien souvent difficile de se souvenir à quoi ressemblait vraiment l’école. Ceux qui s’en sortaient bien se focalisent sur les souvenirs positifs et s’efforcent d’oublier le reste. Ceux qui s’en sortaient moins bien essaient d’évacuer de leur mémoire les outrages subis. En général, ce n’est pas un endroit que l’on aurait envie de revoir. Mais essayez un instant, imaginez-vous arraché à votre famille, envoyé chaque jour dans un endroit étrange où vous vous sentez mal à l’aise, jeté dans une mer de visages inconnus, tous effrayés chacun à leur manière et se défoulant souvent en conséquence sur vous.
Pas nécessairement « sur vous », mais, oui, l'école (comme le monde du travail) contribue à créer la violence de fond présente dans la société par la manière dont elle permet (ou non) de construire des rapports à l'autre (et c'est beaucoup plus profond que le classique "oui, la concurrence entre des personnes, ça craint") : proposons des rapports anxiogènes au sein du deuxième principal lieu de socialisation, l'école, et nous obtiendrons alors une société malade. D'ailleurs, ne dit-on pas "rooh non, mais c'est bon, la cour de récré ça t'endurcit, ça te prépare à la vie en société" ? Pourquoi faudrait-il s'endurcir ? Pourquoi la société devrait-elle être violente en permanence ?
Mais ce qui me frappe le plus quand je retourne dans les salles de classe où j’ai grandi, c’est à quel point elles me semblent petites aujourd’hui. Dans mon souvenir, les professeurs sont des géants et les classes étaient conçues pour d’autres géants comme eux. Les bureaux étaient de grands trucs dangereux, les tableaux noirs semblaient interminables, les bureaux et les tables avaient des formes qui m’intimidaient.
Mais c’était mon univers : jour après jour, ces géants contrôlaient ma vie, et ces enfants étaient mes seuls compagnons. Et que se passait-il dans ces cours ? Je ne pouvais pas explorer le monde ou me livrer à des expériences comme je le faisais chez moi. Je n’apprenais pas les choses comme je les avais apprises jusque-là — en tâtonnant, par l’expérience et l’expérimentation. Non, l’école était l’endroit du « vrai apprentissage » et le vrai apprentissage, me disait-on, c’était le « travail ».
La plupart des cours dans lesquels j’ai été, et la plupart de ceux que j’ai vus depuis — même dans les écoles les plus progressistes — se ressemblaient tous plus ou moins. Le professeur était assis devant la classe et parlait, tandis que les enfants, assis en face de lui, l’écoutaient. Parfois, il y avait une image, un schéma, ou une fiche d’exercices, mais la plupart du temps, ce n’était que des paroles. Pensez au nombre d’heures que nous avons passées assis à ces tables — six heures par jour, 180 jours par an, pendant douze ans — à écouter ces professeurs. Cela fait presque treize mille heures au total, plus de temps sans doute que vous n’en avez passé à regarder des films ou à faire du sport. De toutes ces heures, quel souvenir vous reste-t-il ? J’ai gardé quelques images en tête, comme des instantanés, mais j’ai beau essayer, je ne me souviens pas d’une seule phrase que j’ai entendue. Toutes ces paroles, et je peux à peine me souvenir d’une seule chose qu’ils m’aient dite.
J’imagine que ce n’est pas une surprise. Tous ces cours etaient ennuyeux au possible. Je suis sûr que la plupart du temps, j’avais l’esprit complètement ailleurs ; et je suis sûr que c’était aussi le cas de la majorité de mes camarades. Les professeurs n’étaient pas dupes, évidemment — voilà pourquoi ils nous sommaient de répondre à des questions, ponctuant ces longues heures d’ennui par des moments de panique et de terreur. Vous entendiez votre nom prononcé et, soudain réveillé, vous découvriez les yeux du professeur et ceux du reste de la classe rivés sur vous — tout votre monde en train de vous observer pour voir si vous alliez vous planter. L’éducateur radical John Holt posa un jour a sa classe la question suivante :
Nous étions en train de discuter de choses et d’autres, et tout le monde semblait dans un état d’esprit détendu, alors j’ai dit : « Il y a une chose dont je suis curieux, et je me demande si vous accepteriez de me répondre. » Ils m’ont dit: « Quoi donc ? » Et j’ai dit : « À quoi pensez-vous, qu’est-ce qui vous passe par la tête, lorsque le professeur vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse ? »
Ma question a eu l’effet d’une bombe. D’un seul coup, un silence de mort s’est abattu sur la classe. Ils se sont tous mis à me fixer avec ce que j’ai appris à reconnaître comme une expression d’angoisse. Pendant un long moment, il n’y a pas eu un bruit. Enfin, Ben, un de mes élèves les plus effrontés, a brisé la glace tout en m’offrant une réponse : « Gloups ! », a-t-il lancé d’une voix forte.
Il parlait pour la classe tout entière. Ils se sont tous mis à parler très fort et tous disaient la même chose : quand le professeur leur posait une question dont ils ne connaissaient pas la réponse, ils étaient terrorisés. J’étais sidéré — decouvrir une chose pareille dans une école que l’on considère comme progressiste, une école qui s’efforce de ne pas exercer de pression sur les enfants, qui ne donne pas de notes dans les plus petites classes, et qui essaie de faire en sorte que les élèves n’aient pas l’impression de devoir absolument être les meilleurs.
Je leur ai demandé ce qui les etfrayait tant. Ils m’ont répondu qu’ils avaient peur de se tromper, peur d’être laissés pour compte, peur qu’on les traite d’idiots, peur de se sentir eux-mêmes idiots. […] Même dans la plus gentille et la plus douce des écoles, les enfants ont peur, beaucoup d’entre eux très souvent, et certains presque tout le temps. C’est un fait très concret auquel nous sommes confrontés.
Et cela ne s’arrange pas avec le temps. Même les étudiants en droit vivent dans la peur de cet appel glaçant — ce moment fatidique où, devant toute la classe, le professeur leur demandera de répondre à une obscure question. Et si une telle chose a le pouvoir d’ébranler ces élèves diplômés et accomplis, imaginez l’effet terrifiant qu’elle peut avoir sur des élèves de CP, isolés et impuissants !
La peur vous rend muet. Votre champ de vision se rétrécit, vous commencez à réfléchir désespérément au problème en jeu — non pas à ce que vous en savez ou à ce qu’il signifie, mais juste à la chose, n’importe laquelle, que vous devez dire pour vous en sortir sans encombre. Lorsque le professeur vous pose une question, ce n’est pas le moment d’essayer de comprendre ce qu’il veut dire réellement, ni comment cette question s’inscrit dans un contexte plus général. Pas non plus le moment d’obtenir des éclaircissements sur un point qui vous pose problème. Et pas le moment de vous tromper en toute bonne foi et d’apprendre de votre erreur. L’enjeu, c’est de donner la bonne réponse, rapidement, coûte que coûte.
Les enfants mettent au point des stratégies incroyables pour faire face à ces situations. Ils marmonnent quelque chose, en espérant que le professeur entendra ce qu’il veut entendre. Ils tournent autour du pot, couvrant leurs arrières pour qu’il soit plus difficile de les accuser de se tromper. Ils étudient le visage et les mouvements du professeur pour y trouver un indice — se corrigeant à toute vitesse si son attitude leur laisse penser qu’ils ont donné la mauvaise réponse. L’enjeu n’est pas d’apprendre, mais de survivre.
Jusqu’à présent, les écoles semblent avoir été presque parfaitement conçues pour entretenir la peur des enfants. Même s’ils peuvent survivre à la gêne de s’être trompés devant leurs camarades, d’autres punitions et récompenses existent pour faire en sorte que les enfants restent davantage concentrés sur les réponses que sur la compréhension. Échouez à une interrogation écrite ou à un devoir à la maison et l’on vous blâmera pour votre échec. Cela sera inscrit dans le cahier de classe et communiqué à vos parents, lesquels, en général, vous réprimanderont et vous puniront à leur tour. Les contrôles sont présentés comme une course contre la montre — pas le temps de réfléchir au contexte general ! — et quand ils sont finis, il y a davantage de corvées et de travaux inutiles à terminer.
Une fois la journée d’école terminée, ce n’est pas fini pour autant, même si vous donneriez tout pour un moment d’insouciance. Non, vous rentrez chez vous, mais vous devez encore faire vos devoirs, les mêmes petites tâches inutiles qui se répètent indéfiniment. Vous n’avez jamais un moment pour vous arrêter, pour penser par vous-même. Toute votre vie est surveillée de près — que ce soit par vos parents à la maison, ou par un professeur à l’école.
Vous n’avez jamais le temps pour vous arrêter et vous demander pourquoi. Demander pourquoi, ce n’est pas votre travail. Si vous pensez que le professeur se trompe, tant pis pour vous. Il n y a pas de cour d’appel. Même si vous avez raison, vous avez tort. Comment peut-on demander à quelqu’un de développer du respect pour lui-même, sans même parler d’estime personnelle, dans ce genre de condrt1ons ?
Comment, d’ailleurs, est-on supposé développer quoi que ce soit ? Nous comprenons le monde en fabriquant des modèles, en généralisant à partir de notre expérience, et en mettant ces généralisations à l’épreuve du monde réel. Nous apprenons parce que quelque chose nous intrigue — nous voulons comprendre de quoi il s’agit, ou son fonctionnement, et nous partons à l’aventure pour percer le mystère. Mais à l’école, il n’y a pas le temps pour tout cela. Nous sommes censés rester assis derrière un bureau, non pas explorer le monde. D’ailleurs, nous ne pouvons rien explorer du tout — le monde réel est soigneusement tenu à distance.
Nous sommes plutôt abreuvés d’un flux infini de faits prémâchés : définitions, noms, dates, lieux, équations — tous déconnectés de la réalité, et les uns des autres. Au lieu d’apprendre des choses sur le monde, nous apprenons des faits et des règles choisis au hasard. Et même à propos de ces faits et de ces règles, tout intérêt sincère est proscrit. Quand les cinquante minutes sont terminées et que la cloche sonne, nous devons arrêter de nous intéresser à telle chose pour nous intéresser à telle autre. Mais on ne contrôle pas la curiosité comme l’on change de chaîne toutes les cinquante minutes avec une télécommande. La seule mamere de survivre est de renoncer tout simplement à la curiosité, de se désintéressé des sujets que l’on vous demande d’apprendre, et de les laisser se fondre en une masse indistincte.
Et c’est parfait, parce que c’est une masse indistincte. Un cours de physique n’est pas très différent d’un cours de biologie ou de grammaire. Toute l‘instruction devient une affaire de mémorisation. La seule différence entre les matières est le genre de choses que l’on vous demande de mémoriser — s’agit-il de noms d’animaux ou des parties du discours ? Au lieu d’essayer de comprendre quelque chose, vous essayez juste désespérément de vous en rappeler — du moins assez longtemps pour être capable de le ressortir au moment du contrôle.
C’est un miracle si quelqu’un apprend quelque chose.
Et d’ailleurs, peut-être que personne n’apprend rien du tout. C’était l’idée qui obsédait Éric Mazur.
Aujourd’hui, tout porte à croire qu’Éric Mazur était un bon professeur — un très bon professeur, même. Il enseignait à Harvard — la plus prestigieuse école du pays, si ce n’est du monde. J’ai parlé à suffisamment de professeurs de Harvard, croyez-moi, pour savoir que le simple fait d’enseigner dans cette école suffit en général à leur donner une très bonne estime d’eux-mêmes. Mais même à Harvard, Mazur s’est démarqué.
Prenez les évaluations des enseignants que devaient remplir les élèves en fin d’année, « le très redouté questionnaire de fin de semestre ». Mazur donnait des cours d’introduction à la physique, et la physique n’était pas vraiment une matière très prisée des étudiants. « Quand ils faisaient cours à ces classes préparatoires de médecine, la plupart de mes collègues frôlaient le suicide lorsqu’ils découvraient les résultats […] parce que ces élèves n’étaient pas tendres avec leurs professeurs de physique. Mais ils l’étaient un peu plus avec moi — j’obtenais 4,5 ou 4,7 sur 5. »
Mazur obtenait-il de bonnes notes parce qu’il rendait les choses trop faciles ? Pour le savoir, il regarda les examens. « Je pouvais donner à ces étudiants des questions que je considérais comme assez compliquées — des questions auxquelles je n’étais même pas sûr de pouvoir moi-même répondre sans erreur dans les conditions stressantes d’un examen. Par exemple, un bâton est posé sur une surface sans friction, un palet heurte cette surface, les deux objets restent collés ensemble et commencent à tourner : calculez l’angle et la position rotationnelle en fonction du temps. Aucun problème pour la plupart de ces élèves en classe préparatoire de médecine. »
Il y eut quelques signes avant-coureurs. « Par exemple, certains étudiants écrivaient, à la fin de leur évaluation de fin de semestre : « La physique, c’est assommant. » Ils avaient beau me donner une bonne note, ils écrivaient ce genre de choses. Ou bien : « La physique, c’est vraiment nul. » Je n’ai jamais vraiment compris, et par conséquent, je préférais me concentrer sur les signes positifs et ignorer les signes négatifs.
« Vous savez, mon dentiste m’a dit un jour — et je n’ai même pas pu lui répondre à cause de l’appareil que j’avais dans la bouche — « Oh, vous êtes physicien. J’ai eu un A en physique à l’un1versrte, mais je n’y comprenais rien du tout. » Je suis toujours ennuyé quand j’entends ce genre de choses et je ne sais jamais comment réagir. Je n’ai jamais compris d’où cela venait. »
Puis, en 1990, après six ans d’enseignement, il tomba sur un étrange petit article dans un vieil exemplaire de l’American Journal of Physics. Ibrahim Halloun et David Hestenes, deux physiciens de l’université d’État de l’Arizona, avaient donné à leurs étudiants un examen de physique, mais d’un genre très singulier. La plupart des examens de physique posent des questions très compliquées, qui nécessitent un tas d’opérations mathématiques pour être résolues, comme celle avec le bâton et le palet. Mais au lieu d’augmenter la difficulte de leur examen de physique, Halloun et Hestenes décidèrent de le rendre plus facile. Il n’impliquait aucun jargon ni aucune opération mathematique de haut niveau ; en fait, il ne nécessitait même aucun calcul. Les questions étaient si simples et compréhensibles que l’on aurait presque pu donner cet exercice à une personne n’ayant jamais fait de physique de sa vie.
Pour ces étudiants en physique, elles devaient tenir de la simple formalité. Y répondre n’exigeait pas tellement plus que d’avoir compris les lois de Newton. « La première semaine, on décrit le mouvement
— vélocité, accélération, etc. La seconde, on parle de mécanique newtonienne — les trois lois de Newton. Et ensuite […] les choses commencent à s’élaborer sur ces bases-là. »Bon, vous avez probablement tous entendu parler des lois de Newton. Prenez la numéro 3 : « L’action est toujours égale à la réaction : c’est-à-dire que les actions de deux corps l’un sur l’autre sont toujours égales et de sens contraires. » Même les étudiants en lettres adorent la citer. Peut-être ne savons-nous pas exactement ce qu’elle signifie. Les étudiants en physique, eux, doivent le savoir — surtout ceux qu1 font de la physique de très haut niveau à Harvard.
Eh bien, dans leur interrogation écrite, Halloun et Hestenes ont posé à leurs étudiants une question assez simple sur la troisième loi de Newton. C’était la question numéro 2 — et celle qui s’est finalement avérée la plus difficile de l’interrogation écrite :
- Imaginez une collision frontale entre un gros camion et une petite voiture compacte. Lors de cette collision :
(a) le camion exerce sur la voiture une force plus grande que celle de la voiture sur le camion.
(b) la voiture exerce sur le camion une force plus grande que celle du camion sur la voiture.
(c) aucun des deux véhicules n’exerce de force sur l’autre, la voiture se fait tamponner simplement parce qu’elle se trouve sur la route du camion.
(d) le camion exerce une force sur la voiture, mais la voiture n’exerce pas de force sur le camion.
(e) le camion exerce la même force sur la voiture que la voiture sur le camion.
Alors, selon la troisième loi de Newton, la bonne réponse est la réponse (e). La raison pour laquelle la voiture se fait tamponner et non le camion est, qu’à force égale, l’accélération est bien plus importante pour la voiture, plus petite et à l’arrêt. Mais, bien sûr, la plupart des gens ne le comprennent pas. (Vous ne le comprenez peut-être même pas après mon explication d’une phrase.) Comme la plupart des gens, 70 à 80 % des étudiants en physique choisissent la réponse (a).
Rien de dramatique en soi, sauf que pour un étudiant en physique, cette question relève du ba.-ba. « Tout le reste du semestre — qui dure encore environ neuf semaines — se développe à partir des lois de Newton. Autrement dit, si vous ne comprenez pas les lois de Newton, vous passez globalement à côté de tout ce qui vient ensuite au cours du semestre. » Et pourtant, question après question, à peu près toutes du même genre, c’était devenu très clair : les étudiants n’avaient pas compris les lois de Newton.
« Quand j’ai lu cela, confie Mazur, je n’ai pas vraiment réalisé. Après tout, c’est du niveau lycée » — comment des étudiants à l’université pouvaient-ils se planter là-dessus ? Et a fortiori des étudiants de l’université de Harvard, dont la plupart étaient des as en physique appliquée.
Sachant que la plupart des gens refuseraient de les croire, Halloun et Hestenes avaient réitéré l’expérience dans toutes sortes d’écoles avec toutes sortes de professeurs. Ils firent passer l’examen aux élèves d’un physicien qui mettait l’accent sur les concepts fondamentaux, à ceux d’un autre qui utilisait lors de ses cours plein de démonstrations passionnantes (et avait reçu de multiples distinctions), à ceux d’un autre encore qui enseignait comment résoudre les problèmes par l’exemple, et enfin aux élèves d’un jeune professeur qui n’était pas très sûr de lui et se contentait de lire le manuel. Ils ne purent détecter aucune différence — pas même entre le professeur primé et celui qui récitait le manuel. Evalués avec un simple examen comme celui-là, ils étaient tous aussi mauvais les uns que les autres. Les différentes méthodes adoptées par les professeurs n’y changeaient rien ; les étudiants n’apprenaient toujours rien.
« Je me suis senti mis au défi, se souvient Mazur. Ma réaction, comme vous pouvez vous en douter, a été de me dire : « Pas mes étudiants ! » Après tout, j’étais à Harvard — peut-être était-ce un problème propre au sud-ouest des États—Unis, n’est-ce pas ? […] Je voulais montrer que mes étudiants pouvaient réussir brillamment cet examen. […] À cette époque, on en était à la dynamique rotationnelle, et les étudiants devaient calculer les intégrales triples de corps compliqués avec différents moments d’inertie. Nous étions allés tellement au-delà de la mécanique newtonienne qu’il n’y avait aucune comparaison possible entre [cette interrogation écrite] et ce que l’on faisait effectivement en cours.
« Mais j’étais si impatient de connaître le taux de réussite que je suis entré dans la classe et que j’ai dit à mes étudiants que j’allais leur donner ce quiz. J’ai utilisé le mot « quiz » parce que je ne voulais pas les effrayer — vous savez comment sont les prépas médecine. […] Mais je devais les motiver pour qu’ils s’appliquent, alors je leur ai dit : « Écoutez, si vous vous appliquez pour ce test, vous pourrez utiliser votre résultat pour réviser la prochaine épreuve de milieu de trimestre. » En fait, je vous l’ai dit, l’épreuve de milieu de trimestre traite de questions bien plus compliquées. J’ai donc réalisé, à peine ces mots prononcés, qu’il s’agissait en fait d’un énorme mensonge. Et je craignais qu’après leur avoir dit cela, mes étudiants ne soient vexés en constatant d’entrée de jeu la simplicité du test.
« Comme mes craintes se sont vite dissipées ! Le premier groupe d’étudiants était à peine assis qu’une étudiante a levé la main pour demander : « Professeur Mazur, comment dois-je répondre à ces questions ? En fonction de ce que vous m’avez appris, ou en fonction de la façon dont je réfléchis à ces choses-là d’habitude ? » Comment était-il supposé répondre à une question pareille ?
Bien sûr, les résultats sont tombés et la classe de Mazur n’était pas très différente des autres. « Lorsque j’ai vu à quel point mes étudiants s’en étaient mal sortis, ma première réaction a été de me dire : « Eh bien, peut-être que tu n’es pas un professeur aussi génial que cela après tout. » Mais évidemment, ce ne pouvait pas être vrai, n’est-ce pas ? Donc je ne me suis pas attardé sur cette hypothèse. Alors, pour quelle autre raison les notes pouvaient-elles être aussi basses ? Des étudiants idiots. Mais c’est difficile à dire à [Harvard] ; nos étudiants sont triés sur le volet. Alors j’ai continué à réfléchir un peu, et là, mon esprit, mon esprit tordu, a trouvé l’excuse parfaite : […] l’examen ! Il devait y avoir quelque chose qui n’allait pas avec le test !
« Prenez cette question sur le camion très lourd et la voiture légère. Pas besoin d’avoir fait de la physique pour savoir qu’il vaut mieux pour vous que vous soyez dans le premier que dans la seconde. Alors peut-être que les étudiants confondaient les dégâts causés, ou l’accélération, avec la force — peut-être était-ce juste un problème de sémantique !
« Alors j’ai décidé de réaliser mon propre examen. J’ai décidé d’associer, dans une interrogation, deux types de questions sur le même sujet. L’une était une question classique tirée du manuel, qui serait bien traitée par les étudiants, je le savais. Et l’autre était une question reposant sur des mots, relativement semblable à celle du camion et de la voiture. Et j’ai décidé de laisser de côté la mécanique de Newton, parce que nous avons tous des conceptions intuitives de la mécanique de Newton avant d’avoir eu des cours de physique. J’ai décidé de poser quelques questions sur les circuits CC, les circuits à courant continu. Je pense que très peu de gens ont des conceptions intuitives du fonctionnement des circuits. »
D’accord, donc voilà une question standard (si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas) :
5/ Pour le circuit suivant, calculez (a) le courant dans la résistance 2 et (b) la différence de potentiel entre les points P et Q.
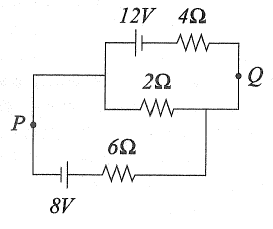
Cette question peut vous paraître impénétrable. Mais pour ces étudiants en physique, il s’agissait d’un problème standard auquel ils avaient l’habitude de répondre. « C’est directement tiré du manuel. Ce n’est pas un problème particulièrement difficile ; il faut à peu près 2/3 d’une page de calculs pour y répondre — mais ce n’est pas une question complètement anodine non plus. »
Maintenant, pour comparer, voici une question conceptuelle :
1/ Un circuit en série se compose de trois ampoules identiques reliées à une pile, comme montré ci—dessous. Lorsque l’interrupteur S est fermé, les valeurs suivantes augmentent-elles, baissent-elles ou restent-elles les mêmes ?
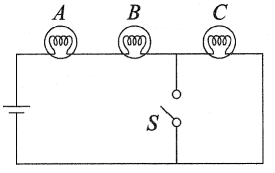
(a) Les intensités des ampoules A et B.
(b) L’intensité de l’ampoule C.
(c) Le courant consommé de la pile.
(d) La chute de tension traversant chaque ampoule.
(e) La puissance dissipée dans le circuit.Cette question n’implique absolument aucun chiffre. « Si vous comprenez les circuits CC, il vous faut 30 secondes pour y répondre, dont 25 pour lire la partie 1.»
« À Harvard, les cours principaux sont enseignés par deux membres de l’université. Donc pour pouvoir intégrer cette question à l’examen, je devais convaincre mon collègue que c’était un bon problème pour un examen. Je lui ai donc montré le problème, et après l’avoir lu, il m’a regardé et il m’a lancé : « Éric, tu as perdu la tête. […] cet examen ne compte que cinq problèmes. On ne peut pas brader 20 % de l’examen avec cet exercice ! » […] Et on a discuté pendant des heures […] S’il a fini par accepter, à contrecœur, c’est surtout parce que l’on n’avait pas d’autres problèmes sous la main. Et l’on a choisi d’en faire le premier problème de l’examen — le problème d’échauffement.
« Eh bien, il s’est avéré que les étudiants ont surchauffé. « Professeur Mazur, le problème numéro un est le problème le plus dur de l’examen ! » Un autre étudiant m’a dit : « Je ne savais pas par quoi commencer avec ce problème. » Que voulez-vous dire par « commencer » ? Commencer un tel problème, c’est déjà le finir ! […] Les étudiants avaient complètement paniqué. Certains avaient pris plus de six pages dans leur cahier d’examen pour écrire absolument tout ce qu’ils savaient sur les circuits CC avec l’espoir que dans le tas, il y aurait la bonne réponse. Et j’ai dû tout lire du début à la fin en quête de la bonne réponse ! »
Quelques mots sur ce problème de physique. La question de base est assez simple : lorsque l’on ferme l’interrupteur, le courant a non pas une, mais deux manières de former un circuit. Il peut emprunter le chemin d’avant, et faire tout le tour (en passant aussi par l’ampoule C), ou il peut juste passer par l’interrupteur.
Alors, une des choses les plus fondamentales concernant les circuits est que le courant emprunte toujours le chemin le plus court. (Le courant est paresseux, si vous voulez). Si vous fermez l’interrupteur, le courant parcourt ce chemin (le plus court) et l’ampoule C s’éteint. Voilà pourquoi tout s’éteint quand il y a un court-circuit. Mais ce n’est pas ce qu’ont pensé les étudiants d’Harvard. La plupart se sont dit que lorsque le courant pouvait emprunter deux chemins différents, il se divisait en deux moitiés et prenait les deux chemins. Ainsi, selon eux, les intensités des ampoules A et B restaient identiques, tandis que l’ampoule C perdait la moitié d’intensité.
On ne peut pas dire qu’il s’agisse simplement d’une question sémantique — quiconque possède un petit matériel de circuit de base qui traîne peut réaliser cette installation et observer ce qui se passe (mais ne le faites pas ; créer des courts-circuits est une opération un peu dangereuse). Soit l’ampoule C s’éteint, soit elle ne s’éteint pas — et l’on pourrait s’attendre à ce qu’un étudiant de Harvard qui excelle en circuits connaisse la bonne réponse. Lorsqu’il a regardé les résultats, Mazur a découvert avec stupéfaction que certains étudiants avaient brillamment répondu à la question traditionnelle, mais s’étaient trompés sur la question conceptuelle. Plus stupéfiant encore, aucun étudiant n’avait fait l’inverse — personne n’avait répondu correctement à ces questions élémentaires et s’était ensuite trompé dans les parties les plus difficiles de l’examen. Personne.
Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, même en physique. Lors d’une expérience, Andrea DiSessa avait demandé à des enfants de jouer à un jeu sur ordinateur qui simulait la physique newtonienne élémentaire. L’objectif était de frapper dans une balle pour atteindre un but. Le psychologue Howard Gardner décrit le cas d’un sujet type :
Envisageons ce qui est arrivé à une étudiante du MIT prénommée Jane, dont le cas fut étudié intensivement par DiSessa. Jane connaissait tous les formalismes enseignés dans les cours de physique de première année. Elle pouvait ressortir l’équation F = ma dans les cas appropriés, elle pouvait réciter parfaitement les lois de Newton sur le mouvement, et elle pouvait utiliser les principes de l’addition vectorielle lorsque cela lui était demandé dans des ensembles de problèmes. Mais dès qu’elle commença le jeu, elle adopta les mêmes pratiques que les élèves naïfs de primaire, partant du principe que la tortue avancerait dans la même direction que le coup. Pendant une demi-heure, elle s’est obstinée dans cette stratégie inadéquate. Ce n’est qu’une fois convaincue que cette stratégie ne marcherait pas qu’elle s’est fait l’observation décisive qu’un objet ne perdrait pas le mouvement qu’il avait avant que le coup soit donné juste parce qu’elle donnait un coup dans une certaine direction. Cette prise de conscience l’a conduite à faire une expérience dans laquelle la vélocité (ou la vitesse dans une direction particulière) de la tortue dynamique était enfin prise en compte.
Comme le soulignait l’expérimentateur:
Nous avons déjà évoqué la remarquable similarité entre l’ensemble des stratégies [de Jane] et celles adoptées par des enfants de ll ou 12 ans. Mais ce qui est tout aussi remarquable est le fait qu’elle n’ait pas, et même n’ait pu, pendant un certain temps, relier cette tâche à tous les cours de physique qu’elle avait eus. Non qu’elle fût incapable de faire les analyses apprises en classe ; son addition vectorielle était, en elle—même, parfaite. C’est plutôt que sa conception naïve de la physique et la physique apprise en classe n’étaient pas liées, et, en l’occurrence, elle avait employé sa conception naïve de la physique.
Cependant, comme l’a montré une série d’études, les erreurs de Jane sont tout à fait typiques des étudiants en physique à l’université. Lorsqu’on leur demanda ce qui arrive à une balle propulsée à travers un tube de forme courbe, les étudiants répondirent qu’elle continuerait à décrire une trajectoire courbe, comme si la balle absorbait la courbe. Lorsqu’on les interrogea sur les forces agissant sur une pièce de monnaie lancée en l’air, 90 % des étudiants ingénieurs répondirent qu’il y en avait deux : la force ascendante de la main et la force descendante de la gravité (en réalité, une fois que la pièce s’est séparée de la main, il n’y a plus que la force de la gravité). Les étudiants qui ont étudié la relativité oublient ce qu‘ils ont appris lorsqu’on les interroge sur le comportement de deux horloges situées à distance l’une de l’autre. Je pourrais continuer, mais passons à la biologie. Même les étudiants qui ont étudié la biologie pendant des années continuent de penser que les caractéristiques qu’acquiert un animal en une génération peuvent se transmettre à ses petits (comme la girafe qui étire davantage son cou pour atteindre de la nourriture plus éloignée). Ils partent du principe que tous les changements qui surviennent chez les animaux sont le fruit d’un changement dans leur environnement et ils croient que l’évolution suit une direction particulière et non qu’elle avance en trébuchant, au hasard. Ils croient que le comportement des animaux répond à une intentionnalité : que les parasites essaient de détruire leurs hôtes, que les caméléons changent volontairement de couleur pour se camoufler. Ils pensent que les plantes aspirent le sol par les racines et que leurs traits génétiques sont répartis selon des proportions précises, c’est-à-dire précisément trois pour un.
On pourrait espérer que la situation soit moins désolante en mathématiques, domaine où ce type de lieux communs est moins répandu. Mais même l’algèbre élémentaire s’avère problématique. Lorsqu’on leur demande de mettre en équation le fait qu’il y a six élèves par professeur, la plupart des étudiants à l’université écrivent : 6e = p. Mais c’est prendre les choses à l’envers. Selon cette équation, le nombre de professeurs (p) est six fois plus grand que le nombre d’élèves (e). Et ce n’est pas de la simple négligence : même lorsque les étudiants sont prévenus de ce problème, ils continuent de faire la même erreur.
Ce n’est qu’un exemple d’un problème plus vaste — les étudiants ne semblent pas vraiment savoir ce que signifient les symboles ; ils connaissent juste quelques opérations élémentaires que l’on peut effectuer avec eux. Lorsqu’on leur soumet un problème qu’ils ne sont pas sûrs de savoir résoudre, les étudiants commencent simplement à ajouter tous les nombres qu’ils voient. Quand on leur demande d’additionner deux fractions, ils additionnent simplement les nombres du dessus, puis ceux du dessous. Et leur compréhension des décimales n’est pas tellement plus brillante : ils refusent de croire que 0,6 est supérieur à 0,5999 et inférieur à 0,6000001.
Les étudiants en informatique sont victimes d’une confusion quasi inverse : ils ne semblent pas comprendre que l’ordinateur ne fait que suivre rigoureusement des règles, et s’attendent au contraire à ce qu’il comprenne ce qu’ils ont écrit, comme le ferait n’importe quel lecteur humain. Ainsi, par exemple, ils se demanderont pourquoi l’ordinateur ne met pas simplement le plus grand nombre dans la variable « max », dans la mesure où c’est manifestement ce qu’ils ont voulu faire.
Les étudiants à l’université qui ont étudié les sciences économiques semblent envisager l’économie à peu près comme le font ceux qui ne les ont pas étudiées. Les uns comme les autres affirment des choses comme: « Plus les ventes augmenteront, plus les prix baisseront, parce que l’on peut toujours conserver le même bénéfice » — affirrnation qui va totalement a l’encontre du rôle que joue le bénéfice dans la théorie économique. La plupart du temps, l’université ne semble pas réellement ébranler ce genre de raisonnement élémentaire. Une étude a montré que le point de vue qu’adoptent les étudiants pour penser les problèmes sociaux et politiques est a peu près le même avant leur entrée à l’université et à la fin de leurs etudes.
Tournons-nous vers les lettres. Une célèbre expérience menée par I. A. Richards a montré que lorsqu’on leur demande de résumer des poèmes, même les étudiants en lettres ont tendance à les comprendre complètement de travers. Non seulement ils ne saisissent pas les sous-entendus poétiques, mais ils semblent incapables de comprendre la signification littérale du texte. Comme l’écrit Richards: « Ils n’arrivent pas a en comprendre le sens, la signification évidente et apparente, en tant qu’ensemble de phrases rédigées dans un anglais intelligible et courant, et considérées hors de toute signification poétique. »
En outre, lorsqu’on leur demanda d’évaluer des poèmes ou le nom de l’auteur avait été retiré, ils donnèrent des notes basses aux poètes les plus célèbres, auxquels ils préférèrent un affreux poème jamais publié écrit par un parfait inconnu. Pourquoi ? Au lieu de chercher la signification, ils avaient simplement donné des notes élevées à des poèmes qui étaient positifs, bien rythmés, et qui utilisaient un vocabulaire empreint de sensibilité.
À chaque fois, on observe le même phénomène : les enfants sont peut-être capables de mémoriser assez de formules et de faits pour passer l’examen, mais ils n’ont littéralement aucune idée de ce dont ils parlent. Lorsqu’on leur pose une question d’une façon légèrement d1fferente ou avec une application pratique, l’apparence de comprehens1on s’effondre, tout simplement.
Les écoles font quelque chose. Nous savons tous qu’obtenir un diplôme augmente nos salaires, même s’il n’y avait pas « littéralement des milliers d’études publiées » qui venaient le confirmer (référence : http://wwwjstore.org/stable/2138394). Mais quelle est cette chose que fait l’école exactement ?
La théorie classique, bien sûr, est qu’à l’école, on apprend. On y va, on apprend des choses, ce qui nous rend plus performants dans notre travail et incite les employeurs à nous payer davantage. Mais les preuves venant étayer cette théorie s’avèrent plutôt difficiles à trouver.
L’économiste Joseph Altonji a essayé de calculer les bénéfices de l’éducation en envisageant les bénéfices de chaque cours de lycée pris à part. Il a comparé les salaires d’individus qui avaient suivi un cours avec ceux d’individus qui ne l’avaient pas suivi, puis il a essayé de calculer combien d’argent supplémentaire gagnait l’élève moyen ayant suivi ce cours. À partir de la, il a effectué la démarche inverse en essayant de déterminer combien d’argent un élève aurait perdu s’il n’avait suivi aucun cours du tout. Le résultat était saisissant : le fait de ne suivre aucun cours n’avait statistiquement aucun effet significatif sur les salaires ; en fait, cela pouvait même les augmenter !
Une étude similaire menée par différents chercheurs, avec des données différentes, et selon une méthode complètement différente, a donné plus ou moins le même résultat : les élèves qui n’avaient suivi aucun cours à l’école étaient payés en moyenne 0,12 $ de plus par heure.
Les mêmes problèmes subsistent lorsque l’on considère les résultats d’un élève dans telle ou telle matière. « La liste des chercheurs ayant échoué à établir un rapport significatif, d’un point de vue économique, entre les résultats aux tests de connaissances et les salaires est longue », fait remarquer l’économiste Andrew Weiss. La réussite aux épreuves scolaires standard de vocabulaire, de lecture, de mathématiques, etc. n’a pas d’effet sensible sur les salaires. De même que le fait d’avoir de bonnes notes ne semble pas être un indicateur de réussite sur le lieu de travail. « La plupart des élèves qui ont travaillé dur à l’école n’en retirent que peu de bénéfices, déplore l’économiste John Bishop. La réussite au lycée telle qu’elle est évaluée par les notes n’explique presque rien des réussites professionnelles […] avoir de bonnes notes n’augmente pas la probabilité de trouver un travail, ni de toucher un salaire concurrentiel une fois que l’on a été embauché. » (référence : http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/400/)
Dernier élément de preuve : le GED (diplôme d’études secondaires obtenu en candidat libre). Si l’école était simplement un lieu d’instruction, les élèves titulaires d’un GED réussiraient à peu près comme ceux qui ont suivi des études secondaires. En effet, les étudiants titulaires d’un GED sont, en moyenne, plus instruits que ceux qui possèdent un diplôme d’études secondaires — après tout, la plupart des lycéens n’ont pas besoin de passer un test de connaissances pour valider leurs années de lycée (dans de nombreux États américains, le high school diploma, équivalent de notre baccalauréat, est délivé au terme des années de lycée, sans épreuves particulières préalables). Mais toute cette instruction ne leur vaut pas grand-chose sur le marché du travail — les élèves titulaires d’un GED réussissent à peu près aussi bien que les élèves ayant abandonne le lycée.
Je ne suis pas convaincu.
D'un côté, il est clair, qu'en France, en informatique, parmi mes connaissances, les personnes qui ont suivi un cursus scolaire peu qualifié en apprentissage, lors de leur entrée dans leur première entreprise (généralement celle qui les a formées) sont largement mieux payées qu'un bac+5 fraîchement diplômé employé par la même entreprise : l'expérience est donc privilégiée à la connaissance pure.
De plus, dans les entreprises où je fus salarié, entreprises réparties en France, il y avait une diversité des diplômes, du bac au bac+5, parfois même pas en informatique et, pourtant, nous avions tous un emploi et un salaire qui dépendait uniquement de notre expérience : tout junior, peu importe son diplôme entrait dans l'entreprise avec tel salaire, point.
De plus, les entreprises qui étaient prêtes à signer mon premier contrat de travail m'ont affirmées toutes les deux que, ce qui avait fait la différence, c'était mon engagement dans un Fournisseur d'Accès à Internet associatif. Oui, dans ma lettre de motivation, j'exposais techniquement et socialement ce que j'avais fait (et échoué) dans ce FAI associatif. Sans ça, je n'étais visiblement pas embauché. Mon joli bac+5 ne m'a pas servi à décrocher un emploi. Durant mon premier emploi (c'est moins vrai pour les autres), c'est bel et bien les compétences développées chez ce FAI associatif et non celles acquises durant mon cursus universitaire que j'ai mis en œuvre. Donc le recruteur ne s'était pas trompé, il avait bien choisi.
De plus, à part pour l'obtention de mon premier emploi, les recruteur⋅euse⋅s ne m'ont plus jamais fait passer de tests techniques afin de vérifier les compétences en amont de la signature du contrat de travail.
De plus, aucune entreprise où je fus salarié ne m'a demandé une copie de mon diplôme. La confiance règne ou bien ce n'est pas important ?
Enfin, parmi mes connaissances, certaines étaient admiratives de mon salaire et attribuaient leur salaire inférieur à leur niveau d'études plus court de 2 ans. À chaque fois, soit en demandant son salaire à un de leur collègue avec un niveau d'études et une expérience similaire à la mienne, soit en postulant directement à une offre d'emploi proposée par leur entreprise, j'ai pu démontrer que non, même avec mon bac+5 j'aurais un salaire de misère identique aux leurs.
D'un autre côté, je ne suis pas sûr que les emplois non-informatiques sont logés à la même enseigne, mais je manque de données de terrain pour l'affirmer.
Précisons que les chercheurs ne se réjouissent pas de ces resultats. John Bishop, par exemple, s’en indigne. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas faire disparaître les faits.
Que font donc les écoles si elles n’instruisent pas la nouvelle génération ? Eh bien, il suffit de regarder ce qui reste : les écoles sont des endroits où les enfants doivent être chaque jour à 8 heures, pendant des années et des années, s’asseoir à des tables inconfortables sous des éclairages fluorescents avec un groupe de quasi étrangers, et obéir aux intructions arbitraires de leurs supérieurs sur la façon appropriée d’effectuer des tâches intellectuelles répétitives. Un simple coup d’œil sur un espace de bureaux moderne vous prouvera que ce sont là des talents très recherchés.
Demandez aux employeurs ce qu’ils attendent de leurs employés, ils ne vous répondront pas une intelligence théorique supérieure. En fait, dans les années 1970, les employeurs se plaignaient que leurs ouvriers étaient trop instruits et nourrissaient par conséquent « des attentes professionnelles irréalistes ». Les « mauvaises attitudes des ouvr1ers » qui en résultaient donnèrent lieu à des « problèmes de productivité et de qualité et (dans certains cas) à du sabotage pur et simple » (référence : Capelli). En effet, les employeurs demandent du « caractère » : « le sens des responsabilités, de l’autodiscipline, de la dignité, du travail d’équipe, et de l’enthousiasme ». En d’autres termes, les employeurs veulent des individus sur qui ils peuvent compter pour effectuer leur travail avec fierté et enthousiasme — et certainement pas des individus susceptibles de se livrer a des comportements répréhensibles et à des opérations de sabotage.
En observant pourquoi les nouvelles recrues qui « ne font pas l’affaire » se font renvoyer durant leurs premières semaines, on peut voir où réside vraiment le problème. Malgré tous ces discours sur le fait que nous avons besoin de meilleures écoles pour être plus compétitifs au sein d’une économie mondiale, une étude sur les employeurs a montré que seuls 9 % des travailleurs étaient renvoyés parce qu’ils étaient incapables d’apprendre à faire leur travail correctement.
Je repense à un stagiaire en fin d'études dans une entreprise où j'étais salarié. Il était curieux : il bricolait différents trucs techniques sur son temps libre dont un serveur de mails complet et il posait des questions pour apprendre (sur IPv6, par exemple). Il aimait bien tout remettre en question et trouver la vérité par la méthode scientifique de l'expérimentation. Je me souviens ainsi d'une conversation / expérimentation sur le fait de savoir si l'adresse IP du visiteur d'un site web telle que remontée par PHP est extraite d'un header HTTP ou depuis autre chose. C'était fondamental à ses yeux car si c'était un header HTTP, la fiabilité de la pseudo authentification qu'il avait trouvé dans le code sur lequel on lui avait demandé de travailler n'avait plus du tout de sens. Pour ceux et celles qui veulent se moquer, j'ai vérifié à l'époque : sa formation n'incluait pas de cours de réseaux informatiques. ;)
Sauf qu'il fut jugé trop lent et surtout trop pénible dans ses remises en question des instructions et des vérités qu'on faisait pleuvoir sur lui, donc il ne dépassa pas sa période d'essai post-stage. Je tiens le motif de son non embauche de son supérieur. ;) Pourtant, avant cet épisode, son boss m'exposais ô combien il avait été opprimé dans sa quête des connaissances dans le passé d'où son amour pour notre entreprise qui lui laissait plus d'air et lui accordait plus de confiance. Soit il avait un double discours, soit on lui a demandé de dégager le stagiaire et il s'est exécuté ce qui mettrait en lumière un problème structurel. Pourtant, il suffisait de guider ce fameux stagiaire quand il s'égarait genre j'ai parfois été sec pour le faire redescendre sur terre quand ses négations de la vérité devenaient du n'importe quoi complet et ça suffisait bien… et ça n'entravais pas sa curiosité, contrairement à la méthode retenue par l'entreprise.
Je bossais dans une entreprise purement technique dont le nom fait rêver le geek moyen à cause des technos utilisées et de l'ambiance soi-disant à la cool, pas dans une grosse boîte bien figée. C'est dire.
Et si l’on considère les travailleurs appréciés de leurs patrons, on découvre qu’ils revêtent plus ou moins les mêmes traits que les élèves appréciés des professeurs : « fidèle au poste », « fiable », « qui s’identifie à son travail/à son école », disposé au renoncement, et faisant preuve d’« altitudes pro-sociales » — c’est-à-dire disposé à en faire le plus possible pour le patron (référence : Edwards 1977).
En résumé, les écoles n’apprennent pas vraiment quelque chose aux enfants, car elles ne visent pas vraiment à apprendre quelque chose aux enfants. Elles visent à apprendre aux enfants à rester tranquilles, à faire leur travail et à être à l’heure.
Ce n’est pas un accident. C’était le plan depuis le début.
Il est difficile d’imaginer à quoi ressemblait l’Amérique avant la révolution industrielle. La notion de liberté était alors bien plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui. Pour beaucoup d’Américains, la vie ne consistait pas à se présenter à son travail à l’heure dite, à obéir aux ordres toute la journée, et à revenir chez soi pour deux heures de « temps libre » — à l’époque, on y aurait vu de l’esclavagisme. Un Américain libre était un homme qui travaillait pour lui et pour sa famille, chez lui, aux heures qu’il voulait, et qui se faisait payer en fonction de ce qu’il avait accompli.
Dans l’organisation du putting—out system (système économique de sous-traitance mis en place aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui a perduré jusqu’à la révolution industrielle), par exemple, les négociants venaient livrer chez vous des matières premières comme le coton. Quand vous le décidiez, vous cardiez, filiez et tissiez le coton pour en faire du tissu. Et la semaine d’après, le négociant revenait pour acheter le tissu que vous aviez produit. Si vous vouliez gagner plus d’argent, il vous suffisait de travailler davantage ou de trouver un moyen pour travailler plus efficacement. Si vous vouliez partir en vacances, personne ne pouvait vous en empêcher — simplement, vous n’étiez pas payé cette semaine-là.
La vie n’était pas parfaite, loin de là. Joindre les deux bouts pouvait s’avérer difficile et il n’existait aucune protection contre la chute des prix ou les ralentissements du marché. Mais les gens étaient libres. Ils étaient leurs propres patrons, suivaient leurs propres règles. Et ce n’était pas une chose que les Américains étaient enclins à abandonner à la légère.
Au début, les manufactures furent elles aussi une promesse de liberté. Aux filles de ces familles, elles offraient une chance de se soustraire à la loi de leur père et de se mettre à travailler pour elles-mêmes — pour leur propre salaire, dans leur propre vie. Au lieu de travailler sous la coupe de leurs parents, les filles de la Nouvelle-Angleterre s’en allèrent dans les ville-usines — de tout nouveaux centres urbains créés le long de la rivière pour pourvoir en main—d’œuvre ces manufactures, premieres véritables usines du pays. Remplaçant les femmes qui filaient le coton chez elles pour en faire du tissu, les filles manœuvraient d’immenses machines actionnées par des turbines à eau pour faire ce même travail à la ville.
Et c’était en effet des filles. Harriet Robinson avait 10 ans quand elle partit travailler dans les manufactures de Lowell, dans le Massachusetts. « J’ai d’abord travaillé dans la salle de filage en tant que « cardeuse », se souvient-elle. Les cardeuses étaient les filles les plus jeunes, et leur travail consistait à carder, à enlever les bobines pleines et à les remplacer par des bobines vides. Je me revois encore, courant a toute vitesse dans le couloir, entre les machines à filer, portant devant moi une boîte de bobines plus grande que moi » (référence : fibre & Fabric: A Record of American Textile Industries in the Cotton and Woolen Trade, 1898, vol. XXVIII, p. 170).
La loi ne reconnaissait pas la femme comme une personne pouvant dépenser de l’argent. C’était une pupille, un appendice, un résidu. […] Soixante ans ont passé et je les revois encore comme si c’était hier — déprimées, modestes, parlant du bout des lèvres, osant à peine regarder quelqu’un en face, tant elles avaient passé leur vie dans la crainte, comme isolées dans la forêt. Mais après le premier jour de paie, quand elles ont senti dans leurs poches le tintement de l’argent dont elles avaient commencé d’éprouver l’influence mercurielle, leurs têtes baissées s’étaient relevées, leurs cous semblaient cerclés de fer, elles vous regardaient droit dans les yeux, chantaient allègrement devant leurs métiers à tisser ou leurs machines, et marchaient d’un pas souple en allant et en revenant du travail » (référence : Harriet Robinson, Loom and Spindle, Applewood Books, p. 68-70).
D’une condition proche du paupérisme, elles se trouvèrent soudain placées au-dessus du besoin ; elles pouvaient gagner de l’argent, et le dépenser à leur guise ; elles pouvaient satisfaire leurs goûts et leurs désirs sans contrainte, sans avoir de comptes à rendre à quiconque. Enfin, elles avaient trouvé une place dans l’univers ; elles n’étaient plus obligées de passer leur semblant de vie comme de simples fardeaux pour les hommes de leur famille. Même le temps appartenait à ces femmes, le dimanche et le soir, une fois la journée de travail terminée. Pour la première fois dans ce pays, le travail des
femmes avait une valeur monétaire (référence : Harriet Robinson, Loom and Spindle, Applewood Books, p. 68-70).Mais si le fait de pouvoir gagner de quoi se loger et se nourrir était libérateur, les conditions qui le permettaient ne l’étaient pas. Bien avant l’avènement de la journée de huit heures, ces filles travaillaient quatorze heures par jour, de 5 heures à 19 heures — avec seulement une demi-heure de pause pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Elles étaient logées à l’étroit avec les autres filles, à deux dans un lit, quatre dans une pièce, avec très peu d’espace ou d’intimité.
Leurs patrons, en revanche, « vivaient dans de grandes maisons, pas trop près des pensions, entourées de beaux jardins qui ressemblaient au paradis pour certaines filles ayant le mal du pays, qui, lorsqu’elles revenaient de leur travail dans les manufactures bruyantes, pouvaient regarder d’un œil envieux à travers le battant parfois ouvert du grand portail, et se remémorer ainsi leurs agréables maisons à la campagne ».
Le travail était dur, mais leur laissait beaucoup de temps pour réfléchir, et bien qu’elles n’aient reçu aucune instruction, ces filles ne s’en privaient pas. Et après le travail, elles lisaient assidûment, leurs livres passant de main en main. Et elles assistaient avec enthousiasme aux exposés des divers conférenciers invités. « Chaque hiver, je donnais une conférence au Lowell Lyceum, se souvient un professeur de Harvard. À l’époque, l’objectif du conférencier était d’instruire, et non de distraire. […] Le Lowell Hall était toujours plein à craquer, et 80 % de l’auditoire était composé d’ouvrières. Lorsque le conférencier entrait dans la salle, chaque fille ou presque avait un livre à la main et le lisait attentivement. Et lorsqu’il apparaissait à son pupitre, le livre était mis de côté et remplacé par une feuille et un crayon; et très peu de jeunes filles rentraient chez elles sans avoir pris des notes exhaustives sur ce qu’elles avaient entendu. Je n’ai jamais vu un auditoire prendre des notes de façon aussi assidue. Non, pas même dans un cours à l’université » (référence : A. P. Peabody, « The Lowell Offering », Atlantic Monthly, avril 1891).
Et au fil de toutes ces réflexions, de toutes ces choses apprises et de toutes ces discussions, elles commencèrent à remettre en question les aspects les moins agréables de leur situation. Lorsque, en 1836, les propriétaires de la manufacture Lowell décidèrent de baisser les salaires de leurs employées, les filles se mirent en grève. « je garde un souvenir très vif de la première grève (ou « turn out », comme on disait a l’époque) », se souvient Harriet Robinson.
Je travaillais dans une des pièces du bas, où j’avais entendu les filles discuter en long et en large, parfois très vivement, de la grève qui était proposée ; j’avais écouté avec grand intérêt ce qui se disait contre cette tentative d’« oppression » de la part de l’entreprise et, bien sûr, je me ralliais à la cause des grévistes. Quand vint le jour où les filles devaient se mettre en grève, celles des salles du dessus donnèrent le coup d’envoi, et elles furent tellement nombreuses à quitter leur poste que la manufacture fut fermée sur-le-champ. Puis, alors que les filles de ma salle demeura1ent indécises, ne sachant que faire, se demandant entre elles : « Tu le ferais, toi ? » ou : « Est—ce qu’on devrait faire grève ? », aucune n’ayant le courage d’initier le mouvement, moi, qui commençais à me dire qu’elles n’allaient pas sort1r, après toutes leurs discussions, j’ai perdu patience et j’ai pris les devants, en lançant avec une bravade enfantine : « Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, moi je vais faire cette grève, même si je dois être la seule », je suis sortie, et les autres m’ont suivie. Quand je me suis retournée et que j’ai vu la longue file qui me suivait, j’ai ressenti une fierté qu’aucun succès ultérieur ne m’a jamais apportée » (référence : H. Robinson, Loom and Spindle, p. 84.).
Elle avait 11 ans.
Ce que ces jeunes filles ont accompli est tout à fait incroyable. Elles montèrent leur propre journal, The Voice of Industry, qu’elles écrivaient, éditaient, imprimaient et vendaient elles-mêmes. Par ce biais, elles organisèrent d’autres manifestations et d’autres grèves, et constituèrent également leur propre liste de candidats aux élections d’État, afin de lutter pour de meilleures conditions de travail et une journée de dix heures. Contre toute attente, leur liste gagna. Les propriétaires, indignés, s’arrangèrent pour que leurs législateurs déclarent les résultats des électrons nuls et organisent un nouveau vote. Avant celui-ci, de grandes affiches furent placardées, menaçant de renvoi quiconque votera1t pour la liste des dix—heures. Et pourtant, la liste l’emporta à nouveau.
Une fois en place, les parlementaires réussirent à faire voter une loi sur la journée de dix heures à la Chambre de l’État, mais, comme c’est habituellement le cas avec une législation progressiste, elle fut coulée par le Sénat de l’État.
Mais leurs articles dans The Voice montrent qu’elles voulaient bien plus que de meilleures conditions de travail. Elles se considéraient comme des esclaves — des esclaves salariées —— et en conclurent que la solution n’était pas seulement d’exiger que leurs patrons soient plus gentils avec elles, ou les paient davantage, mais d’abolir purement et simplement les patrons.
Le travailleur ne sait pas encore contre quel terrible adversaire il se bat. Compétences concentrées sous la forme de machines et travail accumulé sous la forme du capital, l’un et l’autre dirigés par une intelligence supérieure, sont déployés contre lui. Ces forces puissantes, qui devraient être de son côté, devraient être ses serviteurs, ses outils, sont en train de l’écraser. […] Dans le bon ordre des choses, l’endroit où se concentrent les richesses devrait aussi être celui où le niveau de pauvreté est le plus faible, mais aujourd’hui, il en va autrement ; plus l’éclat du capital est étincelant, plus les conditions sordides, la misère et l’humiliation s’imposent à ses côtés (référence : The Voice of Industry, 14 avril 1848)
La solution était très claire :
Au lieu de chicaner, de temporiser et de faire des compromis avec les capitalistes, nous voulons voir les membres de la classe ouvrière acquérir chaque jour plus d’indépendance à travers un système de coopération et de garanties mutuelles. Lorsqu’ils pourront obtenir les moyens de vivre indépendamment des capitalistes, alors et seulement alors, les mots « grève » et « turn out » signifieront quelque chose. Ils doivent renforcer leur position et s’unir de façon à devenir leurs propres employeurs et procéder à leurs échanges commerciaux sans l’interférence d’intermédiaires et de négociants. Laissons-les assumer eux-mêmes les deux fonctions de travailleur et de capitaliste. Tant que nous dépendrons des manufactures de coton pour nos emplois, nous serons oppressés. Ceux qui travaillent dans les manufactures
devraient les posséder » (référence : The Voice of Industry, 10 mars 1848).On est presque tenté de parler de marxisme ici, mais c’était plusieurs années avant Marx. « Ceux qui travaillent dans les manufactures devraient les posséder. » C’était simplement du bon sens.
C'était en même temps que Marx, celui-ci ayant mis des dizaines d'années à théoriser « Le Capital ».
Les propriétaires des manufactures étaient très mécontents de toute cette agitation. Ils renvoyèrent les semeuses de trouble (saboteuses ?) et ajoutèrent leurs noms à la liste noire qu’ils partageaient avec d’autres manufactures. Ils se mirent en quête de personnes plus dociles pour les remplacer. Et ils utilisèrent la mainmise qu’ils avaient sur le logement et les commerces pour essayer de forcer leurs ouvrières à reprendre le travail.
Mais leur plan le plus étonnant fut aussi celui de la plus grande envergure : ils envoyèrent les filles à l’école. Lowell, foyer de la révolution industrielle américaine, foyer de ces filles qui se retournèrent contre lui et conclurent que « ceux qui travaillent dans les manufactures devraient les posséder », fut aussi le foyer des premières écoles américaines.
Les élèves actuels n’auraient aucun mal à reconnaître les écoles qu’ils construisirent alors — ce sont les écoles publiques. « La porte [de chaque école] devra être fermée précisément à l’heure d’ouverture de l’école, et chaque matin, dix minutes seront allouées à la pratique des exercices religieux. » (Aujourd’hui, nous ne prononçons plus que le serment d’allégeance.) « Chaque professeur doit faire l’appel dans sa classe […] le matin et l’après-midi, et doit tenir un registre précis de toutes les absences. » La journée était alors divisée en leçons distinctes, avec « trente minutes pour l’étude de chaque leçon et dix minutes pour chaque récitation ».
Au lieu de punir les élèves physiquement, les enseignants étaient incités à assurer l’ordre « avec les moyens les plus cléments possible » pour instiller « un respect pour le droit, et ainsi un critère d’autonomie dans l’esprit des enfants eux-mêmes ». Les élèves étaient interrogés et notés sur ce qu’ils avaient appris, et, exactement comme aujourd’hui, travailler en coordination avec d’autres élèves était considéré comme « de la triche » et puni. (Peut-être craignaient—ils que s’ils apprenaient à se coordonner, les élèves seraient davantage susceptibles de fomenter des grèves une fois dans les manufactures.)
En 1855, les membres du comité scolaire de Lowell constatèrent qu’ils avaient des soucis avec un parent malavisé qui s’imaginait que les écoles étaient « une république, où le sujet peut remettre en question le pouvoir de celui qui dirige ; alors que l’administration de l’école est et doit être une monarchie absolue […] où aucun sujet ne peut ni ne doit remettre en cause l’ordre ou la loi du chef suprême » (référence : David Isaac Bruck, « The Schools of Lowell, 1824-1861: A Case Study in the Origins, mémoire de licence, université de Harvard, 1971, http://id.lib.harvard.edu/aleph/003824609/catalog). Tout cela pour former les enfants à la démocratie !
Le programme aussi ressemblait beaucoup à celui des écoles actuelles:
[Il associait] de la grammaire, de la géographie, de l’histoire et de la physiologie au programme élémentaire de lecture, d’écriture et d’arithmétiq ue. Mais ce qui est étonnant dans cette extension du programme, c’est l’inutilité fondamentale du matériel traité : [ces cours] étaient entièrement voués à la mémorisation de détails généralement insignifiants. Les candidats à l’entrée au lycée en 1850, par exemple, devaient connaître les noms de la capitale d’Abyssinie, de deux lacs au Soudan, de la rivière qui « traverse le pays des Hottentot », et du désert qui s’étend du Nil à la mer Rouge, et devaient
pouvoir localiser la baie de Bombetoka, le golfe de Syrte, et les montagnes de Lupata. [Les autres sujets étaient traités selon] une méthode similaire, toutes les questions étant consacrées à des connaissances très ciblées, et dans la plupart des cas infimes, sans aucun lien avec les vies actuelles ou futures des élèves qui recevaient ces enseignements.Et en effet, ces études n’améliorèrent pas les performances des élèves dans les manufactures. Des registres minutieux tenus par les propriétaires des manufactures nous permettent de comparer les travailleurs d’usines qui étaient allés à l’école à ceux qui n’y étaient pas allés. Comme pour les élèves actuels, il n’y a aucune preuve d’un quelconque effet de l’instruction sur la productivité des ouvriers (référence : Luft).
Alors pourquoi les propriétaires de manufactures dépensèrent-ils tant d’argent pour construire et faire fonctionner ces écoles ? Ils étaient très clairs sur leur intention. Les cours était justifiés non par leur utilité, mais parce que le fait de les apprendre par cœur était une forme d’« éducation morale » donnant lieu à « des habitudes industrieuses […] et à l’influence hautement morale qu’elle exerce sur la société dans son ensemble ».
Comme l’expliquait un directeur de Lowell : « Je n’ai jamais considéré la simple connaissance, de grande valeur en elle-même pour le travailleur, comme étant le seul avantage d’une instruction reçue dans une bonne école publique. Les plus instruits, en tant que classe, me sont toujours apparus comme dotés d’un sens moral plus élevé, plus disciplinés et respectueux dans leur façon de se tenir, et davantage disposés à se soumettre aux règlements salutaires et nécessaires d’un établissement. »
Non seulement ceux qui étaient allés à l’école se pliaient mieux aux règles, mais ils étaient aussi moins susceptibles de causer des ennuis : « En période d’agitation, je me suis toujours tourné vers le plus intelligent, le mieux instruit, et celui dont le sens moral était le plus développé pour y trouver un soutien et j’ai rarement été déçu. […] Mais les ignorants, ceux qui n’avaient pas reçu d’instruction étaient en général les plus difficiles, agissant sous l’impulsion d’une passion et d’une jalousie exacerbées. »
En d’autres termes, « cette catégorie de personnel qui a bénéficié de l’instruction d’une bonne école publique est la plus souple, la plus disposée à se plier à des exigences raisonnables, et celle qui exerce une influence salutaire et conservatrice en période d’agitation, tandis que les plus ignares sont les éléments les plus réfractaires » (référence : Lettre de H. Bartlett, Esq. à Horace Mann, Lowell, 1er déc. 1841, Horace Mann, Common School Journal, 1842, p. 366). En bref, « les propriétaires de manufactures ont un grand intérêt financier dans l’instruction et l’éducation morale de leur personnel ».
Un autre directeur de Lowell : « J’ai observé que lorsque ces démagogues décident de persuader ces chers employés des manufactures que leurs employeurs sont trop exigeants, oppressifs et ont des attentes démesurées, l’esprit et le sens moral sont en général plus facilement contaminés s’il s’agit d’un ignorant. »
Le comité scolaire de Lowell résuma ainsi leurs constatations : « Les propriétaires trouvent que la formation que reçoivent les enfants dans les écoles est admirablement adaptée pour les préparer au travail exigé dans les manufactures. » Pourquoi ? « Quand [leurs ouvriers] sont bien instruits […], il ne peut pas y avoir de controverses ou de grèves, et les esprits des masses ne peuvent pas non plus être influencés par des démagogues et contrôlés par des considérations temporaires et artificielles. » (référence : Massachusetts Board of Education, Annual Report of the Board of Education, vol. XXIII, 1860, p. 56).
Les élèves, soulignent-ils, « doivent recevoir leurs premières leçons de subordination et d’obéissance dans la salle d’école. Chez eux ils sont soit totalement livrés à eux-mêmes, soit, ce qui est tout aussi néfaste, soumis à une discipline qui oscille entre indulgence stupide et tyrannie exaspérée » (référence : Lowell Mass. School Committee, Annual Report, 1847, vol. XXI, p. 56).
En effet, l’école était tellement importante que les propriétaires de manufactures décidèrent rapidement de la rendre obligatoire. « Nous ne saurions trop insister sur notre conscience des dangers qui nous attendent de la part de [ceux qui] ne fréquentent pas ou n’ont pas fréquenté nos écoles publiques », prévenait le comité scolaire de Lowell. L’école pour tous est « notre garantie la plus sûre contre les mouvements internes » (référence : Samuel Bowles, Schooling in Capitalist Americ: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life, Haymarket, 1976, p. 160).
Les enfants qui ne sont pas allés à l’école « constituent une armée à craindre davantage que la guerre, la peste et la famine », prévenait le comité. « Des tentatives manquées, au cours de l’année passée, de brûler deux de nos écoles […] sont le signe des maux qui rongent ces éléments et qu1 nous menacent » (référence : Samuel Bowles, Schooling in Capitalist Americ: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life, Haymarket, 1976, p. 160).
Plus précisément, des incendies de ce genre étaient le signe d’une résistance publique à l’exercice d’une telle contrainte. En 1837, 300 professeurs furent forcés de s’enfuir de leur salle de classe par des élèves v1olents et déchaînés (référence : David K. Cohen et Barbara Neufeld, « The Failure of High Schools and the Progress of Education », Daedalus, vol. CX, été 1981, p. 87, note 2). En 1844, la population irlandaise fit la grève de l’école, réduisant le taux de présence de 80 %. Le comité scolaire intensifia ses efforts contre l’absentéisme pour les obliger, eux comme les autres, à reprendre le chemin de l’école.
Et tout comme le modèle de l’usine, le modèle de l’école obligatoire se répandit à partir de Lowell. Une analyse de données censurées réalisée par Alexander Field révéla que ce qui conduisait une ville de petite taille à se doter d’une école n’était pas son éventuelle croissance démographique, ni une hausse des salaires, ni l’introduction d’équipements coûteux, mais plutôt l’introduction du système industriel lui-même. Alors que les usines se multipliaient à travers le pays, les écoles publiques faisaient de même.
Et leurs justifications ne changérent pas non plus. Comme le fait remarquer l’historien Merle Curti : « Presque toutes les réunions annuelles de la National Education Association (NEA) se concluaient sur un appel d’éminents pédagogues aux professeurs, leur demandant de l’aide pour réprimer les grèves et surveiller la diffusion du socialisme et de l’anarchisme. Les commissaires à l’Éducation et les rédacteurs en chef de périodiques d’éducation sommaient leurs équipes de poursuivre le même objectif. » Le commissaire à l’Éducation John Eaton affirmait que les hommes d’affaires devaient « comparer le coût de la pègre et des vagabonds aux frais d’une instruction satisfaisante et universelle » tandis que le président de la NEA James H. Smart déclarait que les écoles contribuaient davantage « à la suppression de la flamme latente du communisme que tous les autres organismes réunis ».
« Les pédagogues, écrit Curti, dénonçaient encore et encore les doctrines radicales et présentaient l’instruction comme la meilleure prévention et le meilleur remède. » Les leaders de l’industrie étaient bien d’accord — des dirigeants commerciaux comme Henry Frick, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie et Pierre S. du Pont soutenaient avec enthousiasme la diffusion des programmes d’éducation. Pour reprendre les tenues de la réformatrice sociale Jane Addams : « L’homme d’affaires, bien sûr, n’a pas pensé : « Je vais laisser l’école publique former les garçons de bureau pour mon compte, ainsi je pourrai les avoir à peu de frais », mais il a pensé, et parfois dit : « Apprenez aux enfants à écrire de façon lisible, et à raisonner correctement et rapidement ; à acquérir des habitudes de ponctualité et d’ordre ; à être prompts à obéir, et à ne pas demander pourquoi; et vous les préparerez à se frayer un chemin dans le monde comme j’ai frayé le mien ! » (référence : Merle Curti, The Social Ideas of American Educators, Totowa (New Jersey), Littlefield, Adams, 1959. Extraits (p. 218—220, 228, 230, 203)).
Et telle a été leur attitude depuis. En dépit de tous ces discours sur les pédagogues et les priorités éducatives, les personnes les plus importantes de n’importe quelle école ont toujours été les hommes d’affaires. Ils se plaignent en permanence que nos écoles sont défaillantes, qu’elles doivent abandonner leurs lubies modernes pour en « revenir aux fondamentaux », et que si elles ne deviennent pas plus dures avec les élèves, le marché américain ne pourra pas faire face à la concurrence.
Comme l’a montré Richard Rothstein, ces revendications ne datent pas d’hier. Parce que la raison d’être des écoles n’a jamais été la véritable instruction, les hommes d’affaires, depuis les tout débuts, n’ont eu aucun mal à rassembler des études sur leur incapacité à remplir cette tâche. En 1845, seuls 45 % des meilleurs élèves de Brighton savaient que l’eau augmente en volume lorsqu’elle gèle. Dans une école, 75 % des élèves savaient que les États-Unis avaient imposé un embargo sur les biens britaniques et français durant la guerre de 1812, mais seuls 5 % savaient ce que signifie le mot embargo. Les étudiants, écrivait le secrétaire à l’Éducation, se contentaient de mémoriser les « mots du manuel […] sans avoir […] à penser à la signification de ce qu’ils avaient appris ».
En 1898, un examen à Berkeley révéla qu’au moment de la rentrée, 30 à 40 % des premières années ne maîtrisaient pas bien l’anglais. Un rapport d’Havard révéla que seuls 4 % des candidats « étaient capables d’écrire un essai, d’orthographier ou de ponctuer correctement une phrase ». Mais cela n’empêcha pas les éditorialistes de continuer à se plaindre et à regretter le bon vieux temps. À l’époque où ils allaient à l’école, déploraient les rédacteurs du New York Sun en 1902, les enfants « devaient travailler un peu […] L’orthographe, l’écriture et l’arithmétique n’étaient pas facultatifs, et il fallait apprendre». Désormais, l’instruction n’était qu’« un vaudeville. Il faut sans cesse faire en sorte que l’enfant se divertisse, et il apprend ce que bon lui semble ». En 1909, l’Atlantic Monthly se plaignait que les compétences fondamentales aient été remplacées par « toutes sortes de modes et de fantaisies ».
La même année, le doyen de l’école de Stanford prévenait que dans une économie mondialisée, « que cela nous plaise ou non, nous commençons à voir que nous sommes seuls contre le monde dans une gigantesque lutte de cerveaux et de compétences ». À cause de leurs écoles défaillantes, bien sûr, les Américains n’étaient pas à la hauteur.
En 1913, Woodrow Wilson convoqua une commission présidentielle pour réfléchir aux façons d’améliorer notre compétitivité éducative à l’international. Cette commission découvrit que, durant la Première Guerre mondiale, plus de la moitié des nouvelles recrues de l’armée « n’étaient pas capables d’écrire une simple lettre ou de lire un journal avec facilité ». En 1927, l’Association nationale des manufacturiers déplorait qu’à la sortie du lycée, 40 % des élèves ne savaient pas effectuer de simples calculs ou s’exprimer correctement en anglais.
En 1938, une étude déplorait que les nouvelles méthodes d’apprentissage à la mode négligeaient totalement l’enseignement élémentaire de la graphophonétique : « Les professeurs […] conspirent contre leurs élèves dans leurs efforts pour apprendre ; ces professeurs semblent être résolus à ne jamais désigner une lettre par son nom […] ou à ne jamais montrer comment utiliser les formes ou les sons des lettres pour la lecture. » Une étude réalisée en 1940 auprès de dirigeants d’entreprises « révélait qu’une grande majorité d’entre eux estimaient que les jeunes diplômés étaient moins bons que la génération précédente en arithmétique, en rédaction, en orthographe, en géographie et en questions internationales ».
Un test réalisé en 1943 par le New York Times permit d’établir que seuls 29 % des premières années à l’université savaient que Saint—Louis se trouve sur le Mississipi, et que seuls 6 % connaissaient le nom des treize États d’origine de l’Union, certains pensant même que Lincoln avait été notre premier président. On observait la, commentait le Times, une « ignorance frappante des aspects les plus élémentaires de l’historre des États—Unis ».
En 1947, le rédacteur en chef du service éducation du Times publia un livre intitulé Our Children Are Cheated. Des hommes d’affaires y déploraient le triste état des écoles américaines. L’un d’eux se plaignant d’avoir eu à « mettre en place des cours spéciaux pour apprendre [à ses nouvelles recrues] à […] mettre en œuvre des changements […] Seule une petite proportion d’entre eux [savent] classer Boston, New York […] Chicago […] Denver […] dans l’ordre correct de leur emplacement d’Est en Ouest, ou nommer les États dans lesquels [se trouvent] ces villes ».
Un test mené en 1951 à L.A. permit d’établir que plus de la moitié des élèves de quatrième ne savaient pas calculer une taxe sur la vente de 8 % sur un montant de 8 $. Les journaux se plaignaient que les élèves ne savaient même pas lire l’heure. En 1952, le journal Progressive Education se plaignait des « attaques proférées contre les manuels qui invitent à une pensée curieuse et au raisonnement personnel, […] de la pression croissante invitant à supprimer les « chichis et petites modes » — par lesquels ils désignent des services essentiels comme les crèches, les classes pour handicapés, les expérimentations et les conseils d’orientation, les programmes pour aider les enfants à comprendre et à apprécier leurs voisins issus de milieux différents », ce que l’on appellerait aujourd’hui le multiculturalisme.
En 1958, le U.S. News and World Report se lamenta1t qu’« il y a cinquante ans, un diplôme de lycée valait quelque chose. […] Nous avons simplement trompé nos élèves et trompé la nation en d1str1buant des diplômes de lycée à ceux dont nous savions bien qu’1ls n’avaient pas les qualifications intellectuelles qu’un diplôme de fin d etudes secondaires est supposé sanctionner — et sanctionne en effet dans les autres pays. C’est cette édulcoration des exigences qui nous a placés dans la situation critique que nous connaissons actuellement ».
En 1962, un sondage Gallup révélait que « seuls 21 % de la population consulte des livres ne serait-ce que très occasionnellement ». Et en 1974, le Reader’s Digest s’interrogeait : « Sommes—nous en train de devenir une nation d’illettrés ? [On observe] un affaissement évident à la fois du niveau d’écriture et du niveau de lecture […] à une époque où la complexité de nos institutions exige un degré d’alphabétisation encore plus élevé ne serait-ce que pour pouvoir fonctionner correctement. [Nous] avons la preuve indiscutable que des millions d’Américains supposés instruits ne savent ni lire ni écrire de manière satisfaisante » (référence : Vance Packard cité dans Richard Rothstein, The Way We Were? The Myths and Realities of America’s Student Achievement, The Century Foundation, 1998).
En 1983, la Commission nationale de l’excellence dans l’éducation de Reagan affirma que nos écoles défaillantes faisaient de nous une « nation en danger ». « Si un pouvoir étranger hostile avait essayé d’imposer à l’Amérique les piètres performances éducatives qui sont les nôtres aujourd’hui, nous y aurions certainement vu un acte de guerre », déclarait la commission. En 1988, le président de Xerox prévenait que « l’éducation publique a placé ce pays dans une situation de terrible désavantage compétitif. […] Si les tendances actuelles […] se confirment, les entreprises américaines devront recruter un million de nouveaux employés par an qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter ».
En 1993, le gouvernement reprenait la même rengaine. « La grande majorité des Américains ignorent qu’ils n’ont pas les compétences requises pour gagner leur vie dans une société où la technologie occupe
une place toujours plus importante, et dans un marché qui s’internationalise de plus en plus », se lamentait Richard Riley, alors secrétaire à l’Education. En 1995, le président d’IBM déclara aux gouverneurs que nos écoles avaient besoin de critères plus stricts à « une époque qui exige une amélioration des compétences si nous voulons que les Américains réussissent sur le marché mondial ».Ce genre de plaintes continuent de se faire entendre aujourd’hui. Elles sont toujours suivies d’appels à une « réforme de l’éducation » et à des « critères plus élevés », qui se traduisent toujours en pratique par les mêmes « exercices et compétences » qu’autrefois. Et, bien sûr, c’est exactement le but.
J’entends déjà les objections. « C’est une théorie du complot ! », s’exclament-ils.
D’un point de vue strictement factuel, cette affirmation est une grave erreur. La théorie du complot désigne un petit groupe de personnes qui se sont, en secret, arrangées pour subvertir la façon dont les choses fonctionnent en temps normal. Mon propos est exactement le contraire : il s’agit d’un grand groupe de personnes, qui travaillent au vu et au su de tous, et qui s’assurent que les choses continuent de suivre leur cours normal.
Alors, pourquoi est-ce que cela ressemble autant à un complot ? Parce que dans les deux cas, je pense, il s’agit d’affirmer que les choses ne fonctionnent pas comme les gens ont toujours cru qu’elles fonctionnaient. Dès notre jeune âge, on nous dit que même si la société dans laquelle nous vivons a de nombreux problèmes, elle est fondamentalement sensée. Les écoles existent pour offrir une éducation aux gens, les entreprises existent pour fabriquer des choses que les individus veulent, les élections existent pour donner aux individus l’occasion de s’exprimer sur la façon dont le système est dirigé, les journaux existent pour nous dire ce qui se passe. C’est ainsi que le monde fonctionne, tout simplement.
Maintenant, on peut raisonnablement croire que toutes ces choses ont des défauts — que les écoles, par exemple, pourraient mieux instruire les étudiants. Après tout, les choses peuvent toujours être améliorées, et parfois dans une large mesure. Mais lorsque l’on va plus loin et que l’on soutient que non seulement les écoles sont des lieux où l’enseignement est de mauvaise qualité, mais que leur raison d’être n’est pas du tout d’enseigner quoi que ce soit — eh bien, c’est là que les choses deviennent effrayantes.
Parce que si l’objectif des écoles n’est pas d’enseigner, alors tout ce que l’on nous a dit a leur sujet est un mensonge. Et si tout le monde nous ment, alors cela commence à ressembler à une théorie du complot.
Mais il suffit de regarder notre histoire pour voir qu’il n’y a pas de complot. Un groupe d’entrepreneurs audacieux découvrent qu’ils peuvent fabriquer du tissu plus rapidement en faisant construire de grandes manufactures. Les filles qui travaillent dans ces manufactures ne cessent de causer des grèves et d’autres ennuis, alors les entrepreneurs exigent de leurs employées qu’elles aillent à l’école dès leur jeune âge pour apprendre à bien se tenir.
Mais évidemment, la plupart des gens ne seront pas ravis d’aller à l’école dans le but d’apprendre à accepter des salaires plus bas sans protestation. Alors les patrons trouvent une manière d’enjoliver l’histoire : l’objectif des écoles est d’enseigner aux travailleurs ce qu’ils ont besoin de savoir pour survivre dans le monde du travail. C’est faux, bien sûr — il n’y a pas de rapport entre les faits appris par cœur à l’école et les compétences nécessaires sur le lieu de travail — mais l’histoire est suffisamment convaincante.
Et voilà comment la multiplication des écoles et des usines et détruit le modèle de liberté américain. Au lieu d’être des fermiers indépendants ou des fabricants autonomes, les Américains sont conduits dans les usines en troupeaux, forcés de travailler pour quelqu’un d’autre parce qu’ils ne peuvent pas gagner leur vie autrement. Mais grâce aux écoles, cela semble normal, et même naturel. Après tout, n’est—ce pas ainsi que le monde fonctionne, tout simplement ?
Aujourd’hui, tout le monde semble s’accorder à dire que ce sont des écoles plus strictes qu’il nous faut. George W. Bush s’est associé à Ted Kennedy pour faire voter la loi No Child Left Behind, qui sanctionnait les districts scolaires (comprendre : leur retirait leur financement) qui n’obtenaient pas d’assez bons résultats. (Comment les écoles défaillantes étaient-elles supposées améliorer leurs résultats en ayant moins d’argent ? C’est une chose qui n’a jamais été réellement expliquée.) Barack Obama, bien sûr, n’aurait jamais soutenu un plan aussi cruel. À la place, son programme Race to the Top permettra, comme Skinner, de repérer les écoles qui font quelque chose de bien — et de les récompenser par des financements supplémentaires.
Seulement, les aptitudes testées ne sont jamais les « attitudes pro-sociales » d’un élève ou son « assiduité » — mais plutôt la façon dont il a mémorisé des faits et des chiffres. Pourquoi cette dissociation ? Peut-être parce que le fait de recaler les élèves pour leur manque de persévérance passerait mal auprès des parents. Comme le dit Peter Cappelli, le directeur du Centre national sur la qualité de l’éducation de la population active du gouvernement américain, la plupart des gens sont « perturb[és] » par l’idée « que les valeurs, normes et comportements que l’on inculque aux élèves dans les écoles semblent être en conflit avec les valeurs associées à l’épanouissement et au développement personnels ».
La solution a été de mener le combat sous d’autres noms. No Child Left Behind était supposée avoir pour effet de contraindre les écoles à améliorer leur façon d’instruire les élèves. Qui pourrait trouver à y redire ? Mais quand on examine ses conséquences sur le terrain, on constate que cette loi a eu un tout autre effet. Les élèves, bien sûr, n’étaient pas soumis à des tests pour évaluer la manière dont ils avaient réellement compris les concepts fondamentaux, mais simplement pour évaluer la façon dont ils pouvaient répondre aux questionnaires à choix multiples classiques. Et étant donné l’ampleur des enjeux, l’école a continué sa conversion. D’un lieu supposé enseigner des idées aux enfants, elle est devenue un lieu où l’on apprend à avoir de bons résultats aux tests.
Linda Perlstein a passé un an dans une école qui luttait pour survivre à No Child Left Behind. Tout ce qui n’était pas évalué avait dû être sacrifié — non seulement l’art et la gym, mais aussi les récréations, les sciences sociales et les sciences (oui, pas de sciences dans les évaluations). Le temps restant est entièrement consacré à la préparation aux tests — le seul exercice d’écriture que font les élèves se trouve dans les parties « réponse courte » (« Quel élément de texte aurait-on pu ajouter pour permettre au lecteur de mieux comprendre l’information ? »), et les textes, en classe, sont uniquement analysés en fonction des questions susceptibles d’être posées lors du test.
Une importante partie du temps de classe est en fait allouée à des activités qui n’ont strictement rien à voir avec l’enseignement. À la place, les élèves sont assommés de conseils sur la bonne maniere de passer leur test : respirer profondément, travailler jusqu’à ce que le temps de l’épreuve soit écoulé, éliminer toutes les mauvaises reponses evidentes. Chaque jour, on leur apprend des mots de vocabulaire précis qu1 leur vaudront des points supplémentaires et on leur rappelle comment formuler correctement leurs réponses pour obtenir la note maximum. Au lieu de couvrir les murs de leurs réalisations artistiques, on les tapisse de conseils sur la façon de bien réussir leur test (« RRTA: Reprendre les termes de la question, Répondre à la question, s’appuyer sur le Texte, Adapter la formule »).
L’objectif unique d’obtenir les meilleurs résultats possibles aux tests a été une véritable bénédiction pour le marché des manuels scolaires, qui oblige les écoles à acheter à prix d’or des « programmes fondes sur des données concrètes » dont il a été « prouvé » qu’ils améliorent considerablement les résultats aux tests. Le « package» en question comprend non seulement des manuels et des cahiers d’exercices, mais aussi des textes que les professeurs doivent lire mot pour mot à leurs élèves, comme il n’a pas été prouvé que s’écarter de ces textes améliora1t les resultats aux tests, il est interdit de le faire. Le tout s’accompagne de superv1seurs formés qui passent dans les classes pour s’assurer que les professeurs s’en tiennent bien au texte qui leur a été soumis.
Tout cela est aussi illustré dans plusieurs épisodes de la série « Les Simpson ». Par exemple :
- Sois belle et tais-toi (3e épisode de la saison 15) sur la disparition des matières non évaluées ;
- La conquête du test (11e épisode de la saison 20) sur la préparation exacerbée aux tests à choix multiples ;
- Lisa a la meilleure note (7e épisode de la saison 10) sur les subventions accordées aux écoles "méritantes" ;
- Le flic et la rebelle (18e épisode de la saison 3) sur la valeur des manuels pédagogiques.
L’effet sur les élèves est un crève-cœur. Puisqu’on leur enseigne que la lecture consiste simplement à chercher des « caractéristiques textuelles » particulières au sein d’histoires artificielles, ils apprennent à détester la lecture. Puisqu’on leur apprend que répondre a des questions consiste simplement à passer en revue un choix de réponses multiples, ils commencent à cesser complètement de réfléchir et se contentent de débiter, à chaque fois qu’on leur pose une question, des combinaisons aléatoires de mots qui rapportent des points, « La joie que procure la découverte » est bannie de la salle de classe. L’évaluation est en cours.
Avec des exercices de ce type, les enfants n’apprennent rien du monde qui les entoure. En revanche, ils acquièrent bel et bien des « compétences » — notamment celle qui consiste à savoir suivre des ordres absurdes et à rester assis des heures à une table. Les critiques de ces tests aux enjeux élevés dénoncent que ceux—ci ne fonctionnent pas aussi bien que prévu : les professeurs font cours en vue de l’épreuve au lieu de s’assurer que les enfants apprennent réellement quelque chose. Mais en réalité, peut-être est-ce le but recherché. Après tout, les employeurs en semblent très contents.
Un jour, quelqu'un m'a dit "mais arrête de rager sur ce master en permanence !!! Il est bien ce master, il permet d'employer le plus grand nombre ! Si t'as été recruté selon d'autres facteurs, tant mieux pour toi mais ne la ramène pas !". C'est peut-être à ça que servent l'école et les études supérieures : être un label bidon qui certifie que t'es censé⋅e avoir un certain niveau de compréhension du monde et de la thèmatique étudiée, en l'absence d'autres indicateurs te permettant de le montrer. C'est triste d'en arriver à un label bidon et fade quand on part des bébés et des enfants curieux… Quel gâchi, non ?
Vive la non-scolarisation !
Billet de blog publié le 5 avril 2001.
De quoi s‘agit-il ?
Quand j’ai découvert les écoles Sudbury, je les ai trouvées intéressantes. Après quelques recherches sur le sujet, je les ai trouvées fascinantes. La pièce manquante du puzzle, je ne l’ai trouvée que récemment : la non-scolarisation.
La non-scolarisation est un phénomène encore assez mineur, mais il se développe très rapidement. J’avais déjà entendu parler de la non-scolarisation, et d’associations de nen-scolarisation locales, mais n’arrivant pas à trouver plus d’informations sur Internet, j’en étais venu à considérer les acteurs de ce mouvement comme des espèces de marginaux tentant de « déconditionner » le cerveau des enfants scolarisés. Mais comme je l’ai découvert il y a peu, la non-scolarisation est en réalité une philosophie très forte, basée sur un principe simple : les enfants veulent apprendre. Les thèses de ce mouvement s’appuient sur les écrits de John Holt, qui sont absolument magnifiques.
Non scolariser quelqu’un est d’une simplicité étonnante. Il faut d’abord se soumettre aux exigences légales de son État en matière de scolarisation à la maison (mon État, l’Illinois, est étonnamment libéral à cet égard), puis l’enfant reste simplement à la maison, à explorer le monde comme il l’entend. Ses parents et les autres adultes peuvent lui donner conseils et assistance sur ce qui l’intéresse, mais ils doivent s’efforcer de ne pas le contraindre à faire quoi que ce soit. C’est à peu près tout. Plutôt simple, non ?
Comment je fais ?
J’ai découvert la non-scolarisation grâce à un livre incroyable : Teenage Liberation Handbook (T LH) de Grace Llewellyn. C’est un vrai pavé, mais qui relève du guide pratique, conçu pour vous accompagner étape par étape sur le chemin de la non-scolarisation. Le livre est divisé en trois grandes parties : pourquoi devriez—vous ne pas aller à l’école ; comment sortir du circuit scolaire ; et que faire une fois que vous en êtes sorti. On y trouve beaucoup de passages extraits de Growing Without Schooling, un magazine dédié aux personnes non scolarisées qui leur permet de rester en contact et de partager des idées. (Je m’y suis abonné et vous en dirai bientôt davantage.)
Les exemples tirés de la vie réelle et les expériences concrètes indiquent clairement qu’il ne s’agit aucunement d’un groupe de marginaux allumés, ni même simplement d’un programme destiné aux enfants « doués ». En fait, on peut presque dire que la non-scolarisation transcende toutes les catégories — d’ailleurs, le livre recommande même aux adultes de s’essayer eux aussi à certaines des idées exposées. L’auteur rapporte un grand nombre d’expériences où la non-scolarisation a amélioré les relations au sein d’une famille, « guéri » des cas de dépression ou de « troubles d’apprentissage », et, surtout, a rendu les enfants beaucoup plus heureux.
Diverses études citées dans le livre montrent que les enfants non scolarisés réussissent parfaitement dans le « monde réel » et obtiennent presque toujours de meilleurs résultats aux tests de connaissances que leurs semblables scolarisés — même lorsqu’ils n’ont jamais ouvert de manuel ou suivi de cours conventionnel. En outre, et parce qu’ils ont tout le temps nécessaire pour faire l’expérience d’un vrai travail, comme un apprentissage ou une activité bénévole, ils sont bien plus susceptibles de développer les compétences nécessaires pour survivre dans le « monde réel ».
Comment pourront-ils apprendre sans l‘école ?
TLH dispense divers conseils sur la manière de garder le niveau dans toutes les matières fondamentales (anglais, histoire, mathématiques, sciences, art, etc.) — et recommande rarement d’ouvrir un manuel ou de suivre un cours. La non-scolarisation se concentre plutôt sur toutes les occasions d’apprentissage qui s’offrent à nous dans la vie quotidienne.
Je n’ai pas appris l’anglais à l’école, mais en rédigeant des e-mails et des articles pour ce blog, ainsi qu’en lisant beaucoup. Lorsque j’explique cela à d’autres élèves, ils me répondent : « Oh, j’aimerais bien faire pareil, mais je n’ai pas le temps. » Eh bien, s’ils n’allaient pas à l’école, je suis sûr qu’ils en auraient beaucoup plus. C’est rapide et indolore : il suffit de lire des livres intéressants et d’écrire sur des choses qui vous intéressent. Faites-le pendant quelque temps et vous ferez des progrès à l’écrit — sans souffrance ni grands efforts.
Je n’ai jamais aimé l’histoire. Cette matière m’a toujours semblé être une discussion abstraite sur des événements ou des activités qui n’avaient aucun rapport avec ma vie, et tout simplement aucun intérêt. Pire encore, la seule chose sur laquelle j’étais noté, c’était sur ma capacité à mémoriser ces trucs ennuyeux. Certains élèves de ma classe sont fascinés par l’histoire, et je me suis efforcé de comprendre pourquoi. J’ai fini par percer le mystère : l’école nous apprend l’histoire à l’envers. Les cours d’histoire vont toujours dans le sens chronologique, pour remonter progressivement jusqu’à aujourd’hui. Peut-être est—ce une bonne manière de raconter une histoire, mais pour raconter l’histoire, c’est affreux. Vous commencez dans un endroit que je ne connais pas, à une époque que je ne comprends pas, avec des personnes dont je n’ai jamais entendu parler. Je ne suis pas intéressé et je décroche. La solution est simple : commencez par le présent et remontez dans le temps en essayant de répondre à la question : comment en sommes-nous arrivés là ? D’une part, vous commencerez ainsi dans un univers dans lequel je peux facilement me projeter. D’autre part, vous poserez ainsi une question qui est aussi celle que je me pose : comment en est-on arrivés là ? Encore mieux : je développerai ainsi un « sens de l’histoire » en comprenant réellement comment tous les éléments viennent s’intégrer dans notre situation actuelle. Et selon toutes probabilités, je ne m’endormirai pas.
Beaucoup pensent que les maths doivent s’apprendre à l’école, ou du moins dans les manuels. Cette idée est absolument fausse, et ne fait que montrer à quel point les écoles actuelles s’acquittent mal de l’enseignement des mathématiques. La plupart des écoles n’enseignent pas les maths : elles enseignent le calcul, la manipulation des symboles, etc. Mais ce n’est qu’une petite partie des maths, qui finit d’ailleurs par être aussi la moins intéressante, puisque toutes ces opérations peuvent s’effectuer avec une calculatrice ou un petit ordinateur. En fait, les maths consistent avant tout à étudier des modèles et à développer des théories. Les maths sont un univers de beauté abstraite, rempli d’énigmes pour mettre votre esprit à l’épreuve.
Les sciences ne sont pas la mémorisation de faits sans intérêt, contrairement à ce que douze années de cours de sciences peuvent vous amener à croire. Les sciences sont simplement un processus consistant à poser des questions et à chercher des réponses, processus auquel s’associent les connaissances accumulées lors de ces recherches. C’est ce que l’on appelle la méthode scientifique, et la meilleure professeure de sciences que j’aie jamais eue nous l’a simplement expliqué et nous a laissés explorer le monde. Sa classe était remplie de jouets, d’énigmes à résoudre, et d’objets avec lesquels faire des expériences. Elle nous mettait souvent en garde contre les professeurs qu’elle avait eus étant plus jeune, qui proposaient peu d’activités pratiques et demandaient sinplement aux élèves de lire un manuel du début à la fin. Je ne me doutais pas que ce serait précisément le type de professeurs de sciences que j’aurais pendant toutes les années qu’il me restait à passer à l’école. Mais je réalise maintenant que mes explorations scientifiques n’ont pas besoin de se limiter à sa salle de classe, ni a aucune autre. En fait, le monde qui nous entoure est une immense salle de classe, et nous avons simplement besoin de temps pour l’explorer, et de l’instinct qui nous pousse à poser des questions et à essayer d’y répondre.
L’art est indéniablement une chose qui peut s’apprendre en-dehors de l’école. Tout ce qu’il faut, c’est du matériel et du temps pour laisser sa créativité s’exprimer. En général, les écoles possèdent beaucoup de matériel qui vous permet de tester différentes formes d’art, et il peut être utile de trouver un arrangement avec votre école afin de pouvoir continuer à utiliser ces fournitures. Sinon, il existe de nombreux magasins de fournitures d’art, et beaucoup d’autres manières de trouver le matériel nécessaire. Mais l’ingrédient le plus important, c’est la créativité, qui est une chose qu’il faut cultiver de l’intérieur de soi—même.
Mais n’allez pas croire que la non-scolarisation n’est qu’une nouvelle façon d’apprendre les mêmes matières que celles que l’on apprend à l’école ! Non, il est tout aussi important de faire d’autres choses : devenez apprenti ou bénévole, et apprenez à assumer un « vrai travail » ; montez votre propre entreprise ; faites pression auprès des hommes politiques et essayez de faire bouger notre gouvernement ou la société elle-même ; partez en voyage d’exploration autour du monde et découvrez d’autres cultures et d’autres manières de vivre, etc.
Comme le souligne TLH, l’adolescence, chez un enfant, constitue une période de transformation qui comptera parmi les plus enthousiasmantes et importantes de sa vie. Certaines cultures en marquent le passage par des expériences intenses et déterminantes : la ville se réunit pour exécuter un rituel tribal sacré ; on envoie l’enfant effectuer une quête ou faire un voyage, et on le déclare homme à son retour, etc. Pourquoi faisons-nous comme si de rien n’était, en soumettant notre enfant à un supplice inutile, douloureux, abrutissant et autoritaire ?
Aujourd’hui (4 avril 2001), j’ai visité un musée qui proposait un jeu d’aventure à la manière d’un parc à thème. Comme Indiana Jones, il fallait se hisser à travers des labyrinthes et des passages pour trouver les statues en pierre des esprits de la Raison, de l’Inspiration, des Questions et de la Persévérance. À chaque fois que l’on découvrait une statue, celle-ci chantait une petite chanson vantant son importance. À la fin, quand on les avait toutes trouvées, les statues se réunissaient pour effectuer un petit numéro dansé et chanté sur le fait que le secret de la connaissance est de les équilibrer entre elles. C’était assez pénétrant, et sûrement vrai : quand on a la raison, l’inspiration, les questions et la persévérance, il est difficile de se tromper.
Mais mon enfant ne risque-t-il pas de devenir un ermite, un asocial ?
Curieusement, j’ai entendu dire que certaines personnes n’aiment pas la non-scolarisation non parce qu’elles craignent que leurs enfants n’apprennent rien, mais par crainte qu’ils ne développent pas « de relations sociales saines avec leurs semblables ». On ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.
Premièrement, l’école n’est pas un lieu pour développer des relations sociales. En fait, elle semble même conçue pour les réprimer. Il n’y a presque pas de temps mis à disposition pour la socialisation, et toute démarche en ce sens est découragée pendant la majeure partie de la journée d’école. Tout élève qui développe une véritable relation avec quelqu’un le fait en-dehors de l’école: dans un lieu de rendez—vous du quartier (parc ou centre commercial) ; en allant chez un copain ; ou après l’école. Rien n’empêche un enfant non scolarisé de faire toutes ces choses.
Deuxièmement, qui a décidé que l’on ne pouvait entretenir de relations significatives qu’avec des personnes habitant plus ou moins dans la même zone géographique que nous, et ayant environ le même âge que nous ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’un groupe de semblables extrêmement restreint. Mes relations les plus significatives, c’est en ligne que les ai développées. Aucune de ces personnes n’habite dans un endroit que je pourrais rejoindre en voiture. Et aucune n’appartient à la même tranche d’âge que moi. Même parmi celles que je ne compterais pas comme « amis », de nombreuses personnes rencontrées en ligne ont simplement fait des commentaires sur mon travail ou s’intéressent à ce que je fais. Grâce à Internet, j’ai développé un solide réseau social — chose que je n’aurais jamais pu faire si j’avais dû me limiter au périmètre de l’école.
Mais je ne veux pas de mes enfants chez moi !
Alors, j’ai plus ou moins laissé entendre que la non-scolarisation se déroule uniquement à la maison. C’est faux. Comme je l’ai dit au debut de ce texte, le mouvement de la non—scolarisation considère que les écoles Sudbury en font partie, et les appelle pour s’amuser « les écoles de la non-scolarisation ». Hélas, à travers toutes les recherches que j’ai faites sur les écoles Sudbury, je n’ai trouvé aucune mention du mouvement de la non-scolarisation — les fans du modèle Sudbury qui n’ont pas d’écoles de ce genre près de chez eux seront sûrement ravis d’en apprendre l’existence.
C'est un peu léger, comme réponse. En pratique, peu de personnes sont à leur domicile en journée pour garder leurs enfants et parmi ces personnes, bon nombre n'ont pas les moyens de payer un⋅e gardien⋅ne. Ce qui signifie qu'en l'état actuel, la non-scolarisation est réservée à une frange bien particulière de la population : les CSP+.
Et après ?
Je fonde de grands espoirs dans le développement du mouvement de la non-scolarisation. D’abord, je pense qu’il doit se faire mieux connaître : je n’ai appris que très récemment que la non—scolarisation était un choix possible, et que d’autres l’avaient fait — et j’ai effectué toutes les recherches que j’ai pu sur le sujet. Il y a tellement de personnes qui se plaignent de la qualité des systèmes scolaires actuels, et qui sont prêtes pour un changement de système. La non-scolarisation n’est pas simplement un changement, c’est un raz-de-marée qui renverse tout ce que nous croyons savoir sur le système scolaire et qui propose une alternative totalement différente — et nettement meilleure.
Par ailleurs, je souhaite créer une communauté en ligne pour les personnes non scolarisées. Si vous en connaissez, dirigez-les vers moi. Dites-leur de m’envoyer un e-mail. J ’adorerais voir davantage de partage d’expériences et rassembler toutes les connaissances qui existent dans le monde.
Enfin, je terminerais sur un appel. Si vous avez des enfants, ou connaissez des enfants, qui sont pris dans la monotonie de l’école, offrez—leur une échappatoire : achetez—leur un exemplaire de Teenage Liberation Handbook. Je suis sûr qu’ils vous remercieront. Il est temps que les enfants se lèvent et reprennent le contrôle de leur vie. Notre esclavage n’a que trop duré.
Cet article repose en grande partie sur une discussion que j’ai eue en ligne. Je souhaite remercier tous ceux qui y ont participé et vous invite à rejoindre la discussion si ce n’est pas déjà fait.
Les écrits de John Holt
Billet de blog publié le 29 avril 2001.
Lorsque les gens parlent de non-scolarisation, un nom revient toujours dans la discussion : celui de John Holt, l’inventeur du concept. Il a écrit de nombreux livres sur ses idées et ses théories, mais je crois que les deux meilleurs sont How Children Fai! et How Children Learn.
Comme beaucoup de personnes engagées dans le mouvement de la non-scolarisation, John Holt a d’abord été enseignant. ll avait l’impression d’être un très bon pédagogue, un homme qui avait toujours travaillé dur pour rendre l’apprentissage plus agréable et plus drôle pour ses élèves. Il inventait des jeux, achetait des jouets éducatifs très coûteux, laissait les enfants parler en classe et utilisait des techniques pédagogiques novatrices. Mais il ne [voyait] pas sa méprise.
Ce n’est que lorsqu’il a arrêté d’enseigner et s’est mis à assister à d’autres cours qu’il a commencé à voir où il s’était trompé : il n’avait jamais réellement regardé les enfants — regardé attentivement, je veux dire. Tout au long de son année de méticuleuse observation, il a rédigé des notes à l’attention de ses amis et de l’enseignant avec lequel il partageait la classe, Bill Hull. Ces notes ont été publiées dans l’ouvrage How Children Fail. Remarquant que ce qui se passait dans sa classe n’était pas du tout ce qu’il imaginait, il écrit :
On ne peut pas savoir ce que fait un enfant en classe en le regardant seulement quand on l’interroge. Il faut le regarder pendant longtemps à son insu. […] Il semble que les enseignants n’y puissent pas grand—chose. […] Un enseignant dans sa classe est comme un homme dans les bois, en pleine nuit, avec une lampe-torche très puissante dans la main. À chaque fois qu’il allume sa lampe, les créatures éclairées s’en aperçoivent et ne se comportent donc pas comme elles le font dans l’obscurité.
Il commença à se rendre compte que les élèves n’apprenaient pas ce qu’il leur avait « enseigné », mais faisaient simplement semblant. Il découvrit tous leurs mécanismes de défense et leurs stratégies motivés par la peur, qu’ils utilisaient afin de ne pas passer pour des idiots devant leurs camarades et leur professeur.
Une des techniques « novatrices » qu’utilisaient John et Bill dans leur salle de classe était une balance à fléau. On donnait plusieurs poids aux élèves et ils devaient essayer de deviner où les placer sur le fléau pour atteindre l’équilibre. Voici ce qu’ont dit les élèves lorsqu’on leur a demandé de prédire ce qu’allait faire le fléau :
Abby : Il va peut-être bouger un peu d’un côté — pas beaucoup.
Elaine : Il va peut—être vaciller un peu, puis s’équilibrer, mais pas vraiment. (Elle couvre toutes les possibilités.)
Rachel : Il va peut—être s’équilibrer.
Pat : Il va à peu près s’équilibrer.
[…]
Gary : Je pense qu’il va juste pencher d’un côté — c’est plus sûr.
[…]
Gil : Il va peut—être pencher un peu, puis se redresser.
Garry: Il va rester à peu près comme cela.
Betty : Je pense plus ou moins qu’il va s’équilibrer.
[…]
Betty: Je dirais qu’il va s’équilibrer, juste au cas où il s’équilibre, comme cela on n’aura pas une trop mauvaise note.C’est incroyable à quel point les élèves sont prêts à tout pour se soustraire à l’attention et ne pas paraître idiots.
Plus tard, John décide de remiser son costume d’enseignant et de travailler avec les enfants de façon individuelle. Ce faisant, il s’aperçoit que les élèves qui étaient censés connaître les maths de niveau CM2 sont trop peu sûrs d’eux ne serait-ce que pour compter de deux à deux. il travaille avec eux pour reconstituer leurs connaissances en maths en repartant du début, mais ils semblent encore ne pas se souvenir de ce qu’on leur apprend. Après d’autres expériences du même genre, il abandonne l’enseignement.
Dans How Children Learn, son livre suivant, il décide d’arrêter d’enseigner et passe simplement du temps avec des enfants. Il commence avec ses petits cousins, qui sont des bébés, et remarque qu’ils sont des scientifiques obstinés, toujours à observer et à faire des expériences. Il prend des notes sur leurs investigations scientifiques alors qu’ils se mettent à grandir, à lire, à parler, et à jouer à des jeux. Assez rapidement, il retourne dans des salles de classe en apportant des jouets intéressants auxquels il joue d’abord lui-même. Très vite, les enfants viennent jouer avec lui, et commencent à apprendre des choses grâce à ces jeux.
John s’efforce de ne pas interférer dans leurs activités — de laisser les enfants apprendre et découvrir à leur propre rythme. Sa seule tâche consiste à leur donner de minuscules coups de pouce et à leur offrir un soutien moral. Un jour, il décide de ramener la balance à fléau et la pose simplement au fond de la classe, en disant juste que c’est « une vieillerie que m’a donnée Bill Hull. […] Rien d’important ; vous pouvez vous amusez avec si vous voulez ». Et c’est précisément ce qu’ils se mettent à faire, et une demi-heure plus tard, ils ont tous trouvé comment la faire marcher.
J’ai donné à l’un d’eux, une petite fille, un des problèmes qui, des années auparavant, avaient causé tant de mal à des élèves tout à fait capables. Elle l’a résolu facilement, sachant manifestement ce qu’elle faisait. Je lui ai dit : « Tu as eu du mal à comprendre comment faire ? » , et elle m’a répondu : « Oh non, c’était fastoche. »
Voici comme il l’explique :
[Le premier groupe d’enfants avaient tous du mal] bien que nous avions fait tout notre possible — du moins le croyions-nous — pour créer une situation qui faciliterait la découverte. Nous avons travaillé avec des enfants constitués en petits groupes ; nous avons donné à chaque enfant un problème facile ; nous avons invité les autres enfants à dire si la solution au problème était correcte, et, dans le cas contraire, à expliquer pourquoi. Nous pensions avoir transformé notre classe en laboratoire miniature, et que les enfants se comporteraient par conséquent comme des scientifiques. Mais il n’en était rien, et ce pour une simple raison : c’était notre problème sur lequel ils travaillaient, non le leur.
Hélas, s’il est évident pour beaucoup que ce genre d’explorations et de découvertes libres est la meilleure manière d’apprendre, de nombreux professeurs y voient une menace. Ils veulent être, comme l’explique John, « un tyran (tu ferais mieux de faire ce que je te dis !) et un saint (tu m’en remercieras plus tard) ». Pire encore, même les enseignants bien intentionnés doivent jeter ce genre de jouets pour respecter le programme — ils n’ont pas le droit d’être en retard pour le prochain arrêt de l’« Ivy League Express » (L’lvy League est un groupe de huit universités privées du nord-est des États-Unis, qui comptent parmi les plus anciennes et les plus prestigieuses du pays). Mais les enfants n’apprennent pas de cette façon. En fait, ils se cachent, font les ânes, oublient, se tirent d’affaire en pariant sur l’ambiguïté de leurs propos, ou vous mènent en bateau. Pire encore, ils commencent à penser que c’est ainsi qu’il faut se comporter en toute situation. Mais Holt nous fait espérer qu’une autre manière de faire est possible.
Je ne vous ai rapporté qu’une infime partie du trésor de sagesse que renferment ces livres. J’invite tous ceux qui travaillent dans une école, ou qui croient en une école, à lire How Children Fail — j’y ai davantage appris sur la façon dont pensent mes camarades de classe qu’au cours de toutes les années que j’ai pu passer en leur compagnie. En outre, il fait comprendre à travers des histoires très simples pourquoi l’enseignement seul ne marche pas. Actuellement, le travail de John Holt est poursuivi par Holt Associates, qui publie ses livres et d’autres documents.
Quiconque a des enfants en bas âge devrait vraiment lire How Children Learn. Ce livre décrit en détail la manière dont les enfants apprennent, et, par exemple, vous donne des méthodes pour faire en sorte que vos enfants continuent d’apprendre tout au long de leur vie, au lieu de tout détester en bloc et de laisser tomber dès qu’ils le peuvent, comme le font trop d’enfants. Pour de nombreux enfants, il est peut—être trop tard pour désapprendre les mauvaises habitudes acquises à l’école, mais une chose est sûre: il n’est jamais trop tôt.
- Imaginez une collision frontale entre un gros camion et une petite voiture compacte. Lors de cette collision :
-
Projet de loi égalité et citoyenneté : où en est-on ? - GuiGui's Show - GuiGui's Show - GuiGui's Show - GuiGui's Show
Sun Feb 5 15:02:10 2017 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?WHxqjAHop, le Conseil constitutionnel est passé par là (voir le communiqué de sa décision 2016-745 DC) :
- 19 % des articles ont été censurés sur la forme en cela qu'ils constituaient des cavaliers législatifs (des dispositions insérées par le Parlement qui n'ont aucun rapport, même indirect, avec l'esprit du texte initial) ou qu'ils relevaient d'une violation de la règle dite de l'entonnoir (lors d'une navette, ne peuvent être amendés que les articles qui font encore l'objet d'un désaccord). 1/5 de la loi passe à la trappe ! Que les parlementaires arrêtent de pavoiser sur la qualité de leur travail, plz !
- Les dispositions suivantes ont été censurées et ne seront pas présentes dans la loi finale (beaucoup au motif des vices de forme mentionnés au point précédent, je le rappelle histoire d'éviter les réactions outrées sans fondement que j'ai lues dans la presse) : l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant (dont les violences corporelles) sur les enfants, la pénalisation de la négation de crimes (génocides pas reconnus, crimes contre l'humanité pas reconnus, crimes de guerre pas reconnus, esclavagisme, mêmes ceux pas encore jugés), la liberté totale laissée au gouvernement de légiférer par ordonnance pour créer un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'une école privée hors contrat de l'Éducation nationale, serrer la vis de l'instruction en famille notamment les modalités des contrôles, le fait qu'en cas d'égalité des voix lors d'une élection locale, le candidat le plus jeune l'emportera et non plus le plus âgé.
- Les dispositions suivantes demeurent (et seront applicables) : l'identité de genre entre désormais dans divers points de notre législation (notamment dans les infractions de presse), le congé sans solde d'engagement associatif, les mineur-e-s peuvent créer et administrer une association et être directeur-rice de publication, expérimentation sur 1 an d'un déclenchement systématique des caméras piétons (portées par les forces de l'ordre, prévues par la loi de réforme pénale de juin 2016) lors d'un contrôle d'identité, droit universel à la cantine scolaire dans le primaire, divers aménagement concernant les infractions de presse aggravées (portant sur l'origine, l'appartenance à une nation, une ethnie, une race, une religion, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, l'handicap, etc.).
- 19 % des articles ont été censurés sur la forme en cela qu'ils constituaient des cavaliers législatifs (des dispositions insérées par le Parlement qui n'ont aucun rapport, même indirect, avec l'esprit du texte initial) ou qu'ils relevaient d'une violation de la règle dite de l'entonnoir (lors d'une navette, ne peuvent être amendés que les articles qui font encore l'objet d'un désaccord). 1/5 de la loi passe à la trappe ! Que les parlementaires arrêtent de pavoiser sur la qualité de leur travail, plz !
-
Projet de loi égalité et citoyenneté : où en est-on ? - GuiGui's Show - GuiGui's Show - GuiGui's Show
Wed Dec 28 13:42:25 2016 - permalink - - https://shaarli.guiguishow.info/?2ZpWQALe Sénat a refusé de jouer en deuxième lecture (rejet préalable du texte en commission puis en séance plénière) les 6 et 19 décembre. Le 22 décembre, l'Assemblée a donc adopté ce projet de loi en lecture définitive. Le texte va maintenant être examiné par le Conseil Constitutionnel puisque celui-ci a été saisi par les Parlementaires.
La version du texte examinée fut celle de la deuxième lecture à l'Assemblée qui est acceptable (je n'ai pas dit « convenable » ni « bien » ;) ) sur les 4 points que je surveille (liberté de la presse et liberté d'expression, droit universel à la cantine scolaire dans le primaire, pas d'expérimentation d'un civique obligatoire, contrôle à domicile de l'instruction en famille et sur un nouveau critère de compétence, le gouvernement est chargé de procéder par ordonnant pour décider des mesures d'autorisation préalable à l'ouverture des établissements d'enseignement privés hors contrat).
Aucun amendement n'a été déposé/étudié puisque, selon la procédure, les seuls amendements recevables étaient ceux déposés par le Sénat lors de sa deuxième lecture mais comme la Haute Assemblée a refusé de jouer, il n'y a aucun amendement.
J'avais expliqué ces points de procédure parlementaire dans un autre shaarli : Processus législatif français illustré par le projet de loi Travail.
Et, à part les points que je surveillais, qu'est-ce qu'il dit ce projet de loi ? Je ne vais pas résumer les 224 articles de cette loi fourre-tout mais je retiens :- Congé sans solde d'engagement associatif : 6 jours par an fractionnables par demi-journée, pour les salariés et les fonctionnaires qui sont bénévoles dans une association. Limites : l'asso doit avoir plus de 3 ans, elle doit être 1) b) de l'article 200 du CGI (« organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,[...], à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises) et les personnes en demande de congé doivent être de la direction de l'association ou assurée des fonctions d'encadrement. On dira que c'est un bon début bien maigre en complément du congé de représentation déjà en vigueur ;
- Quasi-harmonisation de la loi avec la jurisprudence : les mineur-e-s de plus de 16 ans peuvent créer et administrer une association (avec l'accord des parents alors que la jurisprudence est moins restrictive) et être directeur-rice de publication. Dans le deuxième cas, la responsabilité civile et pénale des parents reste engageable (loi 1881, tout ça). Bref, une mesure choupi là aussi.
- « En cas d'égalité des voix lors d'une élection locale, le candidat le plus jeune l'emportera, et non plus le plus âgé. ». Petite mesure symbolique choupi mais c'est toujours ça de pris. :-
- « Le texte introduit aussi dans le Code civil « l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Une disposition anti-fessées saluée par des associations comme la Fondation pour l'enfance ou l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. ». On n'est pas au pénal ( ;) ) et je me demande bien comment cela sera appliqué. Visiblement, le Parlement mise sur "les parents changeront car c'est désormais dans la loi". Sauf que cette loi est passée inaperçue au 20h, hein.
- Expérimentation sur 1 an d'un déclenchement systématique des caméras piétons (portées par les forces de l'ordre, prévus par la loi de réforme pénale de juin 2016) lors d'un contrôle d'identité. Cette mesure avait été retoquée lors de l'examen de la réforme pénale. J'espère qu'avec cette expérimentation, les observatoires réussiront à avancer sur la question du contrôle d'identité au faciès, ça fait quand même depuis les années 80 qu'on en parle. :/
- Pénalisation de la négation de crimes contre l'humanité alors que le Conseil Constitutionnel et la CJEU se sont déjà prononcés sur des textes similaires… Voir http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/12/22/31003-20161222ARTFIG00062-loi-egalite-et-citoyennete-cette-atteinte-a-la-liberte-d-expression-passee-inapercue.php
Sources :
- Congé sans solde d'engagement associatif : 6 jours par an fractionnables par demi-journée, pour les salariés et les fonctionnaires qui sont bénévoles dans une association. Limites : l'asso doit avoir plus de 3 ans, elle doit être 1) b) de l'article 200 du CGI (« organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,[...], à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises) et les personnes en demande de congé doivent être de la direction de l'association ou assurée des fonctions d'encadrement. On dira que c'est un bon début bien maigre en complément du congé de représentation déjà en vigueur ;
-
Projet de loi égalité et citoyenneté : où en est-on ? - GuiGui's Show
Tue Nov 15 16:58:35 2016 - permalink - - https://shaarli.guiguishow.info/?o77i5ALe texte produit par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi égalité et citoyenneté a été publié en fin de matinée. Cela fait 8 jours que la commission s'est réunie et on est à 3 jours de la date max pour déposer des amendements. Une fois de plus, on voit la minceur du débat démocratique mais ça, j'en ai déjà parlé.
Sur l'article 37 qui concerne la liberté de la presse :- La plupart des dispositions attentatoires à la liberté de la presse ont été supprimées \o/ : il n'est plus prévu que le délai de prescription passe à 1 an pour les infractions commises sur le net, il n'est plus prévu qu'il puisse être d'entamé une procédure au civil pour demander réparation des dommages d'abus de la liberté de la presse, le Parquet ne peut plus décider de continuer une action engagée si le-a plaignant-e se retire ;
- On conserve une nouvelle sanction pour de l'injure et de la diffamation : un stage de citoyenneté pour apprendre les valeurs de la République, tout ça ;
- On augmente les sanctions possibles pour de l'injure (pas pour de la diffamation) portant sur l'origine, l'appartenance à une nation, une ethnie, une race, une religion : passage de 6 mois de cabane à 1 an et de 22 500 € à 45 000 € ;
- Un juge d'instruction peut ordonner la saisie de tracts qui incitent ou appellent à la haine, qui colportent de l'injure ou de la diffamation portant sur l'origine ou l'appartenance à une nation, une ethnie, une race, une religion ou sexe, identité sexuelle ou handicap, etc.;
-
Pour l'injure et la diffamation portant sur l'origine ou l'appartenance à une nation, une ethnie, une race, une religion ou sexe, identité sexuelle ou handicap :
- Toute personne qui a intérêt à agir ou le ministère public peut demander la fermeture d'un service en ligne contenant de tels propos en référé (juge judiciaire) ;
- Le juge peut requalifier une infraction (entre injure et diffamation) ;
- Une plainte simple (au commissariat) interrompt le décompte du délai de prescription ;
- Ces deux derniers points valent aussi pour des infractions ayant eu lieu en privé (qui, dans le contexte liberté de la presse, sont des contraventions, pas des délits) ;
- Toute personne qui a intérêt à agir ou le ministère public peut demander la fermeture d'un service en ligne contenant de tels propos en référé (juge judiciaire) ;
L'expérimentation d'un service civique obligatoire n'est toujours pas revenue. \o/
Le droit à la cantine scolaire indifféremment de la situation de la famille est de retour (article 47). \o/
Article 14 bis (instruction en famille aka "école à la maison") et 14 decies (ouverture d'établissements d'enseignement privés hors contrat) :- Pour l'instruction en famille : toujours une volonté que les contrôles se déroulent à domicile et de changer la nature des contrôles (« compétences » dans les points à vérifier), ce qui diffère des écoles publiques et des écoles privées sous contrat avec l'éduc' nat', ce qui ne me semble pas être acceptable.
- Pour les écoles privées hors contrat : le Parlement laisse la main au gouvernement pour prendre des mesures d'autorisation préalable à l'ouverture en remplacement des procédures de déclaration qui ont cours en ce moment… Ce n'est pas acceptable. Ces mesures devront être prises dans 6 mois au plus tard, soit avant la présidentielle. Je ne sais pas si le but du gouvernement est d'empêcher la droite de faire n'importe quoi sur ce sujet sur lequel elle est chaude. Ça me paraît gros : l'Assemblée aura la dernier mot sur ce texte et la gauche de gouvernement est majoritaire donc ça ressemble plus à un artefact de procédure dont je ne pige pas encore la finalité…
- La plupart des dispositions attentatoires à la liberté de la presse ont été supprimées \o/ : il n'est plus prévu que le délai de prescription passe à 1 an pour les infractions commises sur le net, il n'est plus prévu qu'il puisse être d'entamé une procédure au civil pour demander réparation des dommages d'abus de la liberté de la presse, le Parquet ne peut plus décider de continuer une action engagée si le-a plaignant-e se retire ;
-
Projet de loi égalité et citoyenneté : où en est-on ?
Mon Nov 7 12:43:20 2016 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?o77i5ALe Sénat a adopté ce texte en première lecture le 18 octobre. Comme on est en procédure accélérée, il y a une seule lecture par chambre. Donc la Commission Mixte Paritaire, chargée d'harmoniser/synthètiser la version Assemblée et la version Sénat s'est réunie le 25 octobre pour constater… qu'elle n'arrivera pas à produire un texte de consensus. On commence donc une deuxième lecture, à l'Assemblée à partir de demain. La version de travail est celle issue du Sénat, c'est-à-dire avec tous les articles qui posent question.
Article 37 : modification de la loi relative à la liberté de la presse
- Le délai de prescription de l'action publique passe à 1 an si l'infraction a été commise en ligne ;
- Le-a plaignant-e n'est toujours plus obligé de qualifier précisément les faits (tel bout est de la diffamation, de l'injure, autre chose ?) car il-elle ne risque plus de voir sa plainte devenir nulle. De même, un juge peut requalifier l'infraction.
- Il est toujours possible d'entamer une procédure au civil pour demander réparation des dommages sauf pour les journalistes qui adhérent à une charte de déontologie. Quid des sources ? Quid des citoyen-ne-s (oui car cette loi est le seul bout qui protège la liberté d'expression en France) ? Cette distinction pro/pas pro n'est pas sérieuse. :/
- Il est toujours possible de demander la fermeture d'un site web en référé (donc juge judiciaire, hein) pour des cas de diffamation portant sur l'orientation, le sexe ou handicap.
- Les peines sont aggravées lorsque les infractions sont commises par un dépositaire de l'autorité publique et pour les infractions portant sur l'orientation, le sexe ou le handicap.
- Le Parquet peut toujours décider de continuer toute action engagée, même lorsque le-a plaignant-e se retire.
Article 12 nonies : l'expérimentation d'un service civique obligatoire voulue par l'Assemblée n'est pas encore revenue.
Même chose pour le droit à la cantine scolaire.
Article 14 bis et 14 decies : toujours une déclaration préalable avant d'ouvrir une école privée hors contrat, des contrôles qui changent de nature (ajout de « moralité » et de « compétences » dans les points à vérifier). Pour l'instruction en famille : toujours une volonté que les contrôles se déroulent à domicile et de changer la nature des contrôles comme déjà dit.
- Le délai de prescription de l'action publique passe à 1 an si l'infraction a été commise en ligne ;
-
Primaire à droite: les nouveautés du deuxième débat [ mes notes sur le deuxième soit-disant débat de la droite ]
Thu Nov 3 23:20:17 2016 - permalink - - http://www.bfmtv.com/politique/primaire-a-droite-les-nouveautes-du-deuxieme-debat-1052474.htmlJ'ai loupé une bonne partie du début et je n'ai pas la prétention d'avoir tout noté/retenu/compris mais voici quelques notes :
- Quand Sarko ou Copé parlent d'« administration sous le contrôle du politique », on pense "le président ordonne et le gouvernement exécute". Mais on oublie que l'administration c'est plus large que ça.
- Copé et Le Maire qui veulent gouverner par ordonnance pour l'un et par référendum pour l'autre. Les ordonnances, c'est le meilleur moyen d'éradiquer encore plus le débat public. Quand j'entends Poisson nous expliquer que les procédures d'écriture de la législation dans l'urgence sont suffisantes, je suis scandalisé : je préférerais qu'il dise que ces procédures sont indignes d'une démocratie.
- Juppé qui appelle à se torcher le cul une fois de plus avec la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en matière de déchéance de nationalité, je trouve ça totalement aberrant et indigne d'un candidat à la présidentielle.
- Plus de flics, plus armé-e-s, avec des conditions d'exercice de la légitime défense assouplies voire une inversion de la charge (la légitimité est acquise par défaut et il faut faire la preuve qu'elle ne l'est pas) pour Sarko, augmenter les peines et la réponse pénale, créer plus de places en taule, réduire la majorité pénale à 16 ans (Sarko), etc. Ils et elle sont tous OK pour plus de sécuritaire gerbant basé sur des faits divers. Entends-tu le bruit des bottes ? Merde.
- Le Maire qui essaye de nous embrouiller : quand on parle de juge pour ordonner l'interpellation préventive de quelqu'un, on parle de juge administratif. Faut arrêter de brouiller les lignes, à moment donné : la justice administrative n'est pas la garante des libertés mais est le faux-nez du Ministère de la Police.
- Sarko est toujours bloqué sur son idée de rétention administrative (d'abord pour des personnes suspectées de terrorisme à l'étranger de retour sur le territoire national mais ça sera étendu par la suite, il ne faut pas se faire d'illusions).
- Fillon est toujours bloqué sur la déchéance de nationalité, y compris pour les personnes qui n'ont que la nationalité française. Il prétend, seul contre le reste du monde, que cela serait autorisé par les textes nationaux, européens et internationaux. S'il le dit…
- 3/7 candidats sont d'avis que nos intérêts économiques priment sur nos valeurs dans nos relations avec le reste du monde. S-U-P-E-R !
- Sarko qui veut une majorité parlementaire fidèle et loyale : oui, voter des textes sans aucune opposition ni aucune possibilité de débat, c'est toujours plus agréable quand c'est par conception et que l'on n'a pas besoin d'utiliser le 49.3 et autres artifices de procédure, c'est sûr ! Bref, on continue à transformer le Parlement en un bête exécutant de l'exécutif. Un chef unique pour les gouverner tous-toutes.
- Copé qui veut les uniformes, la Marseillaise (chant guerrier par excellence) et une autorité accrue à l'école. SOS, SOS !
- Sarko qui persiste avec son service militaire obligatoire notamment pour les jeunes entre 18 et 25 piges qui seraient sans emploi. Déjà qu'il a œuvré pour virer les gens de Pole emploi après 3 refus d'une offre jugée "compatible et acceptable"…
- Juppé qui croit encore au mythe du retour à la croissance dans les années à venir. Allô, il faut se réveiller et proposer autre chose, allô, on n'aura plus jamais 5% de croissance ni même 3% !
- Poisson qui est pro-instruction en famille et écoles privées en et hors contrat avec l'éduc' nat' (et c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour porter cette voix là). Malheureusement, son « retour aux solidarités naturelles », ça pue l'anti-LGBT et l'exclusion.
- Le Maire = Fillon (voir http://shaarli.guiguishow.info/?xH1M7g ) = récit national historique. Quand l'histoire ne te plaît pas, laisse ton président bienveillant la réécrire !
- Perdre 30 minutes à causer de la possible alliance avec Bayrou et/ou avec Le Pen mais putain qu'est-ce qu'on s'en fout ! Il n'y a déjà pas le temps pour débattre des vrais sujets, pas la peine de perdre du temps inutilement, bordel !
ÉDIT DU 04/11/2016 À 11H35 : ça me sidère que même Mediapart (https://www.mediapart.fr/journal/france/041116/debat-de-la-primaire-sarkozy-transforme-en-punching-ball ) n'a rien relevé d'autre que les querelles politiciennes de bas étage. Presse différente, où es-tu ?! FIN DE L'ÉDIT.
- Quand Sarko ou Copé parlent d'« administration sous le contrôle du politique », on pense "le président ordonne et le gouvernement exécute". Mais on oublie que l'administration c'est plus large que ça.
-
Appels téléphoniques à mes sénateur-rice-s concernant le projet de loi égalité et citoyenneté
Fri Sep 30 22:12:09 2016 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?yKeokASuite à une énième horreur dans le projet de loi égalité et citoyenneté dont j'entends parler, la modification du droit de la presse, j'ai décidé de téléphoner à mes sénateur-trice-s pour leur faire part de mes inquiétudes et de ma volonté que le bullshit s'arrête dès maintenant.
Le projet de loi sera examiné en plénière du Sénat dès mardi prochain (le 4 octobre) pour un vote sur l'ensemble du texte le 18 octobre. Il n'y avait donc pas assez de temps pour envoyer des mails. Sachant que, de toute façon, la limite pour poser des amendements est dépassée. On est en procédure accélérée (une seule lecture par chambre puis CMP).
Modifications de la loi sur la liberté de la presse de 1881 (article 37)
En commission spéciale du Sénat, nos élu-e-s ont ajouté :
- Aujourd'hui, la prescription de l'action publique (délai après lequel une infraction ne peut plus être faire l'objet de poursuites) en matière de délit de la presse court (= est enclenché) à partir de la date de la première publication du contenu litigieux (ou d'une ré-édition d'après la jurisprudence établie). Les amendements sénatoriaux font que ce délai pourrait désormais courir à partir de la date de retrait du contenu, uniquement pour la presse en ligne.
- Aujourd'hui, une plainte en matière de délit de presse s'interrompt automatiquement si le plaignant se retire. Le projet de loi propose que cet automatisme ne soit plus acquis.
- Le juge aurait désormais la possibilité de requalifier un délit civil et les plaignants auraient la possibilité d'une réparation des préjudices sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Ce que j'en comprends :- Ce texte intervient dans un contexte et avec un historique. Faire taire la presse, c'est un vieux rêve. Je rappelle que plusieurs député-e-s ont déposé des amendements lors la première promulgation de l'état d'urgence, en novembre 2015, pour explicitement contrôler la presse, la radio, le cinéma, etc. Ce n'est donc pas anodin de retrouver des miettes dans ce projet de loi !
- J'interprète l'asymétrie de traitement entre presse papier et presse en ligne comme une volonté de censurer les médias en ligne qui sont ceux qui ont révélé les plus grosses affaires ces derniers temps genre les prétendus millions libyens de la campagne 2012 de Sarko, genre les prétendus agissements sexuels de Baupin, genre les documents de l'affaire Bettencourt, etc.
- Les contenus sur Internet sont faits pour durer dans le temps donc un délai de prescription qui court à compter de la date de retrait n'a aucun fondement. Cela signifie en réalité qu'il n'y a plus de prescription. Une personne physique ou morale peut très bien porter plainte des années et des années après la publication d'un contenu. Exemple ? Les sociétés commerciales non cotées qui essayent de s'acheter une virginité avant d'entrer en bourse. Cas concret : http://www.nextinpact.com/archive/64648-cgu-sebsauvage-tuto4pc-eorezo-adware.htm . Au-delà de ça, tout notre droit est basé sur l'idée qu'au bout d'un moment, on pardonne, on oublie, on n'est plus capable de recevoir des preuves fiables, etc. Revenir sur cela me semble être extrêmement dangereux.
- La requalification et la réparation des préjudices pourront permettre de faire dégager des articles, des contenus, qui peuvent gêner par leur négativité mais ne pas être pour autant un délit de presse. À quoi je pense ? Aux grands patrons & co qui attaquent en diffamation (qui est un des délits de presse) tout article légèrement négatif au sujet de leur société commerciale. Genre Xavier Niel, patron de Free, est un spécialiste du domaine.
Il faut bien comprendre que la diffamation est devenue la meilleure arme de défense, y compris quand les faits relatés en bonne et due forme sont avérés ! Les journaux ont autre chose à faire que d'aller en justice en permanence ! Cela a aussi un effet de concentration de la presse : ne peuvent exister que les grands groupes qui ont les moyens de payer des avocats. Ce n'est pas acceptable.
C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas modifier l'équilibre apporté par la loi de 1881.
Ce que mes interlocuteur-rice-s m'ont dit :- Le principal point de désaccord porte sur le fait qu'Internet est très viral et qu'on y retrouve tout des années après alors qu'un article de presse papier, ça s'oublie dans les jours qui suivent sa publication.
- Pour moi, il ne faut pas croire que le moindre contenu qui sera publié aura des millions de vues. Mes interlocuteur-rice-s m'ont assuré qu'on parlait bien de la même chose c'est-à-dire de la grosse feuille de chou en ligne bien établie. OK. Il ne faut pas croire non plus que les papiers vieux de 5 ans et plus apparaissent comme cela dans un moteur de recherche, surtout quand les sociétés commerciales et les personnalités publiques font de l'optimisation SEO.
- Ensuite, pour moi, la viralité des contenus de presse est le reflet de la société : oui, quand je vois un truc crade, je le partage, à l'oral au bistro, à l'écrit sur mon shaarli, dans mes associations préférées. Internet change l'ampleur du partage, oui, mais j'ai envie de dire qu'un truc crade n'a pas besoin de cela pour se diffuser dans la société. Et la colère que cette action crade suscite est partagée au-delà des RT et like que l'on voit sur le web. Nier ça, c'est être dans le mythe du gros rageux derrière son écran !
- Internet change la temporalité. Oui, mais c'est à double tranchant :
- En tant que citoyen-n-e, homme-femme politique, société commerciale, association, je n'avais pas le temps d'éplucher toute la presse papier y compris la presse locale qui peut me tirer dessus (parce que j'ai un site de ma société commerciale dans le secteur, parce que j'ai été un-e élu-e local-e, etc.) ou tirer sur un-e ami-e local qui m'éclaboussera. 3 mois pour vérifier tout ça, c'est compliqué. Même avec des personnes payées pour produire des revues de presse. Avec le numérique, vérifier que la presse parle de moi, c'est facile, ça ne prend pas 3 mois. Y'a les alertes Google et les services du même genre sans compter l'immédiatement de l'information. Il n'y a donc pas besoin d'allonger ou de supprimer le délai de prescription.
- Que les contenus restent en ligne ad vitam æternam n'est pas un problème : la prescription des délits de la presse n'empêche pas d'attaquer pour d'autres motifs et d'utiliser, par exemple, la LCEN pour exiger le retrait de contenus. Illustration : https://framablog.org/2014/03/14/getty-images-vie-privee/
- En tant que citoyen-n-e, homme-femme politique, société commerciale, association, je n'avais pas le temps d'éplucher toute la presse papier y compris la presse locale qui peut me tirer dessus (parce que j'ai un site de ma société commerciale dans le secteur, parce que j'ai été un-e élu-e local-e, etc.) ou tirer sur un-e ami-e local qui m'éclaboussera. 3 mois pour vérifier tout ça, c'est compliqué. Même avec des personnes payées pour produire des revues de presse. Avec le numérique, vérifier que la presse parle de moi, c'est facile, ça ne prend pas 3 mois. Y'a les alertes Google et les services du même genre sans compter l'immédiatement de l'information. Il n'y a donc pas besoin d'allonger ou de supprimer le délai de prescription.
- Pour moi, il ne faut pas croire que le moindre contenu qui sera publié aura des millions de vues. Mes interlocuteur-rice-s m'ont assuré qu'on parlait bien de la même chose c'est-à-dire de la grosse feuille de chou en ligne bien établie. OK. Il ne faut pas croire non plus que les papiers vieux de 5 ans et plus apparaissent comme cela dans un moteur de recherche, surtout quand les sociétés commerciales et les personnalités publiques font de l'optimisation SEO.
Instruction en famille et écoles privées hors contrats (article 14 bis et 14 dices)
Le gouvernement a proposé :
- L'ouverture d'une école privée hors contrat serait désormais soumise à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État. ÉDIT : non, à une déclaration préalable. Pas de contrôle systématique avant ouverture. FIN DE L'ÉDIT.
- L'instruction en famille serait soumise à des contrôles plus nombreux et à domicile.
Ce que j'en comprends :- Là encore, ces articles de loi ont une histoire : droite dure sécuritaire, risque de radicalisation tout ça, voir http://shaarli.guiguishow.info/?QGLM4Q et https://shaarli.guiguishow.info/?_-WFTA. Donc on est calibré pour empêcher la radicalisation, blabla.
- J'ai déjà longuement présenté les différentes alternatives à l'école de l'éducation nationale et leurs modalités de déroulement / contrôle, voir les liens ci-dessus donc je ne reviens pas là-dessus.
- Il n'est pas question d'autorisation préalable pour une catégorie de méthodes d'enseignement et pas les autres. On ne doit pas chercher à entraver préventivement. Je veux dire : personne ne m'empêche préventivement de tuer quelqu'un-e. Si je le fais, la justice me rattrapera. Même chose pour une école.
- Même chose pour l'augmentation du nombre de contrôles visant l'IEF : je veux un traitement égal des différentes méthodes d'enseignement. Si on renforce les contrôles IEF, on renforce les contrôles des écoles labellisées éducation nationale. Si l'on change la nature d'un contrôle (genre la proposition de loi de 2016 voulait vérifier que les écoles privées hors contrats sont sont conformes « aux valeurs de la République »), on le fait pour toutes les catégories.
- Ce qui me gêne dans les deux cas (écoles privées hors contrat et IEF), c'est qu'il y a une présomption de culpabilité, un a priori négatif : ces deux cas vont forcément faire l'objet de dérives, vont forcément foirer. Ce n'est pas acceptable.
Ce que mes interlocuteur-rice-s m'ont dit :- Tous les lieux d'enseignement ne se valent pas : les écoles de l'éduc' nationale ont des profs dont c'est le métier et la passion, blablabla. Donc, il n'est pas hallucinant d'appliquer des contrôles plus nombreux et/ou renforcés à IEF et hors contrat. Or, pour moi, toutes les alternatives se valent.
- L'État doit veiller sur tous-toutes les futur-e-s citoyen-ne-s. Si quelque chose se passe mal dans une école privée hors contrat ou en IEF, alors le bon peuple gueulera que l'État est responsable. Et puis, on fait quoi des "déchets" qui n'auront pas le niveau en fin de course et échoueront leur entrée dans la vie active ? Ce à quoi je réponds : un contrôle égalitaire suffit à dire que l'État à jouer son rôle auprès des personnes qui considèrent que l'État doit être derrière le cul de tout le monde, tout le temps pour résoudre tous les problèmes du monde.
- Incompréhension de la motivation des IEF. Croyance que ces personnes expriment forcément de la défiance envers l'État. Je trouve ça curieux : quand on parle d'AMAP, il-elle voit très bien que ce n'est pas forcément de la défiance vis-à-vis de la grande distribution mais aussi une envie de consommer local, de participer à la vie économique locale, etc. Quand on parle de FAI associatif, il-elle voit que ce n'est pas forcément de la défiance vis-à-vis des opérateurs existants et qu'on ne cherche pas à nuire/remplacer Orange. On a donc 3 contextes de réappropriation. On a 3 alternatives qui peuvent toutes engendrer des dérives graves. On a 3 alternatives qui peuvent être accusées d'exister uniquement par défiance vis-à-vis de la norme. Mais l'IEF focalise la peur… Ce n'est pas logique.
- Il y a très clairement l'idée que ceux-celles qui pratiquent l'IEF ou qui sont scolarisés dans des écoles privées hors contrat veulent s'exclure et ne pas faire société. Il y a une très forte idée que le système majoritaire est trop bien et que les alternatives minoritaires sont vaseuses. C'est trop bizarre car l'avis change du tout au tout quand on parle d'AMAP…
Divers
- Les député-e-s avaient introduit un droit à la cantine scolaire pour tous et toutes qui a été dégagé par la commission spéciale du Sénat. Voir http://www.politis.fr/articles/2016/09/pas-de-droit-a-la-cantine-35403/ . D'après ce que m'a expliqué une assistante parlementaire, le débat s'est cristallisé sur "mais qui va payer les nouveaux locaux qu'il faudra construire pour accueillir tout le monde ?". Pour moi, c'est évidemment du bullshit vu le taux d'élèves qui mangent à la cantine. Évidemment, je soutiens les député-e-s qui voulaient de la solidarité et le fait qu'un-e gosse ne soit pas exclu parce qu'un des parents est un chômage et autres cas concrets qui se voient tous les jours.
- Je refuse l'expérimentation d'un service civique obligatoire ajouté par les député-e-s (ÉDIT DU 03/10/2016 À 9H40 : ça a été supprimé en commission spéciale du Sénat et il faut que ça le reste FIN DE L'ÉDIT). Un service civique volontaire, ça peut s'envisager. J'y suis réticent mais je peux accepter cela en compromis. Mais pas de service civique obligatoire, jamais.
- Je suis totalement d'accord avec le gouvernement qui veut que les logements sociaux ne soient pas tous groupés ensemble mais qu'un certain pourcentage de ces logements soit intégré au reste de la ville. l'idée étant de ne pas avoir des classes moyennes avec uniquement des classes moyennes, des riches avec des riches et des pauvres uniquement avec des pauvres. On peut tous et toutes traverser une mauvaise passe et devenir pauvre. Ajouter l'exclusion à la pauvreté, ça ne peut que mal se terminer.
En gros, selon moi : pour l'instruction en famille et les écoles privées hors contrat, les dés sont déjà lancés. Même chose pour le droit à la cantine et l'expérimentation du service obligatoire. Des amendements défendant la liberté de la presse ont été déposés par… le gouvernement. Les logements sociaux vont couler beaucoup d'encre semble-t-il genre le gouvernement ne semble pas vouloir lâcher. Le dernier mot irait donc à l'Assemblée après une CMP échouée ?
- Aujourd'hui, la prescription de l'action publique (délai après lequel une infraction ne peut plus être faire l'objet de poursuites) en matière de délit de la presse court (= est enclenché) à partir de la date de la première publication du contenu litigieux (ou d'une ré-édition d'après la jurisprudence établie). Les amendements sénatoriaux font que ce délai pourrait désormais courir à partir de la date de retrait du contenu, uniquement pour la presse en ligne.
-
N° 3704 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à renforcer l'encadrement des établissements privés hors contrat et à limiter les possibilités de dérogation à l'obligation scolaire
Et voilà ! Un peu plus de 2 ans après l'UMP sénatorial, Les Républicains de l'Assemblée remettent le couvert avec une proposition de loi anti instruction en famille (IEF) et qui serre la vis des écoles privées. Voir ici pour un historique et un bilan de la dernière tentative de fin 2013 : http://shaarli.guiguishow.info/?QGLM4Q et http://shaarli.guiguishow.info/?Air7MATue May 17 16:18:54 2016 - permalink - - http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3704.asp
Il y a beaucoup d'inconnu et d'incompréhension sur ce qu'est l'instruction en famille et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui.
D'abord, en France, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui l'est. Elle l'est entre 6 ans et 16 ans. Les établissements d'enseignement ont la priorité, pas plus (L131-1-1 du Code de l'éducation). Parler de renforcement de l'obligation scolaire est donc une sottise (oui, je sais, c'est tout un titre dans le Code de l'éducation tout comme on a un Code de la propriété intellectuelle qui ne veut rien dire). Lisez vous-même l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 dite loi Ferry : http://classes.bnf.fr/laicite/references/loi_28_mars_1882.pdf .
Ça signifie donc qu'il existe une palette de possibilités pour répondre à cette obligation d'instruction :
* École de la République dont le CNED (cours à distance, y compris primaire / collège / lycée) ;
* École privée sous contrat ;
* École privée hors contrat. Sachant que les 5 premières années d'une école privée sont toujours hors contrat ;
* Instruction en famille.
Actuellement, l'école privée et l'IEF sont soumises à un régime déclaratif : il n'y a pas d'autorisation préalable.
École publique, privée et IEF sont soumises à des contrôles.
* Pour l'école privée, ce contrôle porte sur (Article L241-4 du code de l'Éducation) : la moralité, l'hygiène, la salubrité et le fait que l'enseignement n'y est pas contraire ni à la morale, ni à la Constitution ni aux lois + Article L131-1-1 qui s'applique aussi à l'école publique et qui vise le niveau des connaissances, la constitution d'une personnalité et le partage les valeurs de la République ;
* Pour l'instruction en famille, ce contrôle porte sur : l'aspect sanitaire-social (l'instruction est-elle compatible avec l'état de santé de l'enfant et les conditions de vie de la famille ?, Article L. 131-10) + le même article L131-1-1 que pour les écoles.
Dans les deux cas, comme on le voit, les enfants doivent partager un même socle d'acquis.
Halte aux clichés : les bénéficiaires de l'IEF ne sont pas des handicapé-e-s physiques ou mentaux, ni des reclus-e-s asociaux, ni des fils et filles de bourges dont les parents rentiers ont le temps d'instruire leur enfant (ou de payer un précepteur) grâce à une aisance financière, ni des enfants qui échangeront uniquement avec leur famille et quelques proches. Il y a de tout, comme à l'école de la République. IEF != enfermement. Tout comme chômeur ne doit pas signifier gros boulet asocial (exemple : http://jcfrog.com/blog/cest-confirme-je-suis-plus-utile-au-chomage-onvautmieuxqueca/ ).
L'IEF constitue une alternative comme les Fournisseurs d'Accès à Internet associatifs, le Libre (logiciel et culture), les circuits de consommation courts et équitables, etc. Faut pas chercher plus loin ni diaboliser plus que ça.
Basiquement, je suis un noob au sujet de l'instruction en famille (j'ai été scolarisé dans le public, de la maternelle au master, sans interruption et j'en sors extrêmement déçu sur les aspects contenu des programmes qu'est-ce que l'on retient de ces 20 ans d'école ?!) , organisation/flexibilité du taff, personnalisation du cursus et absence de formation à la vie publique en tant que citoyen éclairé) et je n'ai pas envie de contre-argumenter sur tous les clichés donc je vous redirige vers deux BD réalisées par une bénéficiaire de l'IEF : http://www.tarmasz.com/2015/03/lecole-la-maison-partie-1.html et http://www.tarmasz.com/2015/07/lecole-nest-pas-obligatoire-partie-2.html .
Quels sont les motifs de nos député-e-s pour soumettre cette ppl ?
En 2014, les motifs étaient : « Elle [ l'IEF ] ne peut être le prétexte d'une désocialisation volontaire, destinée à soumettre l'enfant, particulièrement vulnérable, à un conditionnement psychique, idéologique ou religieux. [...] ». Par mail, les sénateurs dépositaires ont également ajouté vouloir aller contre « la dimension éducative de la montée du communautarisme dans les cités. » + « certaines dérives communautaristes et intégristes inquiétantes » + « je considère l'école comme le lieu irremplaçable de scolarisation, toutes dimensions confondues ».
En 2016, les motifs sont : « la déscolarisation d’un nombre croissant d’enfants, surtout des filles, pour des motifs d’ordre essentiellement religieux d’une part, et la multiplication d’écoles privées hors contrat prônant un islam radical, d’autre part. [...] Les enfants sont alors victimes de propagande idéologique sous couvert de programmes éducatifs alternatifs. Ils risquent d’être marginalisés et embrigadés, car ils ne disposent pas encore de l’esprit critique qui leur permettrait de conserver leur liberté de conscience. [...] Or, certains de ces établissements présentent non seulement de graves faiblesses pédagogiques mais également des risques de radicalisation religieuse. Beaucoup sont en effet sous l’emprise des Frères musulmans, qui prônent un islam radical. [...] le renforcement de l’obligation scolaire est indispensable pour assurer le droit de tous les enfants à l’instruction, à l’éducation et pour favoriser l’épanouissement de leur personnalité. Dans un contexte de menace terroriste inédite couplée à un développement sans précédent du communautarisme ».
Comme on peut le voir, la sottise se recycle : communautarisme, intégrisme, religion. On y ajoute une petite mention au terrorisme pour actualiser le texte ni vu ni connu.
En quoi cette ppl est dangereuse ? Quelle est ma position sur ce texte ?
* Cette ppl porte atteinte à la liberté de choix, à la liberté d'entreprendre, au simple fait de choisir de faire selon telle méthode puis de faire, sans autorisation préalable. Tout ça pour, au mieux, prémunir d'un risque alors que la vie c'est le risque. Il ne peut y avoir de sanctions prédictives.
* Je veux que chaque "méthode" (école publique, privée ou instruction en famille) co-existe et soit traitée à égalité. Pas d'autorisation préalable, ni pour ouvrir une école privée (ce que réclame l'article 1), ni pour l'IEF. Pas d'interdiction de l'une ou l'autre (ce que réclame l'article 4 pour l'IEF). Si tu renforces les contrôles de l'une, tu les renforces pour toutes. Les critères des contrôles sont déjà assez flous comme ça, notamment pour les écoles privées : l'enseignement et le lieu d'enseignement doivent être conformes à la morale. Qu'est-ce que la morale ? Est-elle universelle ? Est-elle intemporelle ? Je ne pense pas.
* Chaque façon de faire à ses dérives potentielles. Inutile d'en diaboliser / pénaliser / interdire une plus que les autres. Point.
* Les articles 2 et 6 sont extrêmement dangereux. Le premier dispose que les contrôles des enseignements des écoles privées soient conformes « aux valeurs de la République ». L'article 6 stipule quant à lui que les contrôles de l'IEF vérifient que « l'enfant ne fait l’objet d’aucune influence idéologique ou politique contraire aux valeurs de la République. ». Tout enseignement est empreint d'idéologie : les auteurs étudiés en cours de langue/éco/socio/philo, etc. On est sur des critères flous, qui peuvent fluctuer, qui sont à la libre appréciation de l'inspecteur. Pente glissante.
* L'enfermement sur soi / en communauté est possible dans tous les cas et l'école ne diagnostique généralement pas ces cas car on ne peut pas gérer l'aspect humain de 30 élèves, ce n'est pas vrai. Cet enfermement sur soi à l'école est plutôt visible chez des enfants en situation de handicap, par exemple. Ou dans des situations de pauvreté dans lesquelles l'enfant n'a pas accès aux mêmes divertissements coûteux que ses petits camarades. Mais évidemment, ça dépend de chaque individu et de sa force mentale (je ne trouve pas le terme exact :- ).
* Un endoctrinement est possible partout, aussi bien à l'école publique que dans les écoles privées que dans les familles. Je veux dire :
* Les profs ont un pouvoir de prescription. Y'a qu'à voir le lobbying autour des calculatrices que chaque prof de maths/physique recommandera. Y'a qu'à voir le lobbying de Microsoft/Apple au ministère de l'Éducation.
* Le savoir transmis est validé en amont. Par qui ? Le ministère et les syndicats enseignants ? C'est donc lié au pouvoir. Sur quelles bases ? Des réécritures de l'histoire restent possibles. Et même sans aller jusque là, on peut prioriser, ça suffit largement. Qui a décidé que, quand j'étais lycéen, la construction de l'UE devenait enfin importante et donc qu'il fallait l'étudier en sciences économiques ? Qui a décidé que la théorie néo-libérale devait être prépondérante dans ces mêmes cours ? Un cours d'éco, c'est piger le fonctionnement de l'économie (micro|macro)scopique, la théorie néo-libérale n'est qu'un modèle parmi d'autres pour décrire une réalité. Celui qui est déployé, certes, mais il n'explique pas tous les rouages. Qui décide de ne pas parler du massacre du 17 octobre 1961 ? Qui décide de présenter une version pro-américaine de la seconde guerre mondiale ? Qui décide de dire que « BGP est une arme de guerre économique » ? Le gouvernement de Vichy qui renomme les cours d'« instruction morale et civique » en « instruction morale et patriotique », ça fait tilt ?
* Je rappelle qu'il y a des contrôles, aussi bien pour l'école (publique ou privée) que pour la famille.. On peut juger leur nombre insuffisant aussi bien dans le cas des écoles privées hors contrat et IEF comme le font les député-e-s de la proposition de loi, que pour les écoles publiques. Souvenez-vous du nombre de profs que vous avez vu se faire contrôler durant votre scolarité. Dans mes souvenirs, j'en vois deux. Dont un m'expliqua que c'était suite à sa demande d'évolution dans la hiérarchie. On peut vouloir renforcer les contrôles et/ou les multiplier, c'est une autre question tant qu'on l'applique à écoles + IEF sans distinction.
* On peut être tenté de faire une comparaison entre l'école dans laquelle on suppose que l'enfant fréquentera tout un tas de personnes, que ce soit des profs ou des enfants de son âge à une vision faussée de l'enfant seul dans le cas de l'IEF pour en déduire une diversité d'opinions et donc une meilleure construction citoyenne à l'acole. La diversité des gens rencontrés n'empêche pas le conformisme dans les idées et n'apporte pas forcément une diversité d'opinion notamment quand on empêche le brassage multiculturel (ZEP, tout ça ;) ). Les profs sont souvent assez "plan plan" / "je suis à la lettre le programme établi par le ministère". Au mieux, certains se permettent des remarques / de l'ironie mais il n'y a pas de fond derrière, libre aux élèves de creuser. Quant aux conversations des élèves dans la cour de récré, ça cause majoritairement de choses peu structurantes comme des boobs, de la taille de la queue, du programme TV qu'il fallait forcément avoir regardé la veille, des jeux vidéo du moment (Pokemon et GTA Vice City dans mon cas < 3 ) et de faire suivre des rumeurs/moqueries. À l'université, ça cause plus des devoirs à rendre. Bref, le nombre de personnes fréquentées ne fait pas la diversité.
Actuellement, deux pétitions demandant le retrait de cette ppl co-existent :
* https://secure.avaaz.org/fr/petition/Au_gouvernement_francais_dans_son_ensemble_CONTRE_LA_PROPOSITION_DE_LOI_Ndeg_3704_du_27_avril_2016/
* http://www.citizengo.org/fr/34390-retrait-proposition-loi-visant-supprimer-lecole-maison
Je n'ai pas changé d'avis en 2 ans : je pense toujours que les pétitions (notamment celles en ligne) ne sont pas sérieuses (regardez la crédibilité de la deuxième, par exemple : on sent une absence de relecture post-publication et un mauvais usage du pouvoir des images). Une pétition permet de donner un chiffre (combien de personnes sont opposées) mais pas les arguments qui vont avec. Or, si le débat n'avance pas, la cause n'avance pas et elle se fera attaquer à nouveau sur les mêmes idées fausses.
C'est pour ça qu'avec quasi les mêmes gus-sse-s, on a pondu un mail destiné à l'ensemble des député-e-s qui ont déposé cette ppl en leur nom. Le voici, si ça peut vous inspirer :
« Mesdames les Députées,
Messieurs les Députés,
C’est avec consternation que nous apprenons l’existence de la *proposition de loi « visant à renforcer l’encadrement des établissements privés hors contrat et à limiter les possibilités de dérogation à l’obligation scolaire »* enregistrée en vos noms à la Présidence de l’Assemblée nationale[1] le 27 avril 2016.
En France, le choix de la méthode d’instruction est libre et soumis à la seule discrétion des familles. *Cette liberté est également inscrite dans la convention européenne des droits de l’homme et dans la convention des droits de l’enfant. Or, les critères stricts définis à l’article 4 interdisent, de fait, toute possibilité de recourir à l’instruction en famille* par choix. Cette restriction est inacceptable.
Toutes les formes d’enseignement (école publique, école privée, instruction en famille) *doivent co-exister et être traitées sur un pied d’égalité. Une autorisation préalable ne peut être nécessaire pour certaines et pas d’autres*, et toutes doivent être soumises aux mêmes *contrôles qui ne peuvent porter sur des jugements de valeur pouvant fluctuer* tels que l’absence d’idéologie ou les « valeurs de la République », termes génériques et creux permettant toutes les dérives et tous les formatages.
*Toutes les formes d’enseignement sont susceptibles de dérives et aucune ne doit donc être diabolisée. Si la radicalisation est un problème actuel, l’instruction hors contrat n’en est pas la cause, et l’école de la République n’est pas la solution miracle* (cas des ZEP, mauvaises influences comme la vente de stupéfiants devant les établissements, etc.). L’instruction en famille peut même permettre aux proches de réagir plus promptement et plus pertinemment à des influences radicalisantes subies par leur enfant, du fait d’un meilleur suivi de leur instruction et éducation. N’oublions pas que plusieurs contrôles à caractère social et pédagogique sont prévus par la législation actuelle et devraient suffire à détecter toutes dérives et permettre à l’Éducation nationale d’agir. *Les familles jugées « dangereuses » iraient-elles vraiment choisir l’instruction en famille*, sachant pertinemment que l’Éducation nationale, ainsi que les services de la mairie pourraient tout aussi bien se rendre compte d’un problème ?
*Concernant la radicalisation religieuse, vos propos sont incohérents* : vous dites « Beaucoup [d’établissements] sont en effet sous l’emprise des Frères musulmans, qui prônent un islam radical. » puis « il existe 300 établissements confessionnels [toutes confessions confondues, sur 1300 écoles privées hors contrat] ». Sauf erreur de notre part, la majorité des *auteurs d’actes terroristes récents étaient scolarisés à l’école de la République*, que ce soit Mohammed Merah, Bilal Hadfi, Samy Amimour, les frères Abdeslam ou bien encore Quentin Roy.
Votre proposition de loi inclut un passage dérangeant : « le renforcement de l’obligation scolaire est indispensable pour assurer le droit de tous les enfants à l’instruction, à l’éducation et pour favoriser l’épanouissement de leur personnalité ». *L’école de la République conditionne elle aussi* les futurs citoyens à sa façon que ce soit par le contenu des programmes (établis/influencés par le ministère et les syndicats d’enseignants) ou dans la cour de récréation. Un conditionnement unique de l’ensemble des citoyens ne nous semble pas souhaitable. *Les enfants instruits en famille ont beaucoup plus d’occasions pour s’épanouir grâce à une souplesse dans l’organisation de leur éducation* qui leur permet de bénéficier d’un plus large éventail d’expériences : projets créatifs, sorties culturelles, séjours prolongés pour une immersion dans un milieu d’apprentissage (à l’étranger ou dans les milieux intellectuels ou artisanaux), vie associative… *Cette souplesse permet réellement à l’enfant de mieux s’intégrer à la société et d’en devenir un acteur éclairé*.
À l’heure du numérique et d’Internet, à l’heure où de prestigieuses universités mettent leurs cours de grande qualité à la disposition de tous (MIT[2], Havard[3]) , *ce texte est une attaque frontale envers cette modernité, cette niche économique* en devenir, cette force d’innovation et de progrès sociaux. Ignorer les moyens d’éducation non-étatiques équivaut à fermer des portes pour l’avenir à la fois de l’enfant et du pays entier. Ce serait se mettre des œillères alors qu’on pourrait voir *l’éducation dans la famille et l’autoformation à égalité avec la fréquentation assidue d’établissements* de l’Éducation nationale.
Une force (souvent louée, notamment en terme de nouvelles technologies) de pays étrangers et notamment des États-Unis d’Amérique, c’est aussi une plus grande *acceptation de l’acquisition du savoir et savoir-faire hors cursus* : ce n’est pas le diplôme qui compte mais les *qualités réelles acquises* d’une quelconque manière au choix de l’élève/étudiant, ce choix qui justement ici est voué à être encore plus bafoué.
Nous ne sommes pas les seuls citoyens inquiétés par cette proposition de loi puisque *plusieurs pétitions* ont été lancées (Avaaz[4], CitizenGo[5]).
Une proposition de loi similaire[6] (vous reprenez strictement les *mêmes arguments ressassés*) a déjà été déposée il y a un peu plus de deux ans au Sénat. Nous nous y étions déjà opposés et la proposition avait finalement été retirée. Il est usant de devoir encore et toujours défendre une simple liberté de choix.
Cette proposition de loi, qui surfe sur les thématiques actuelles de la peur de ce qui n’est pas normalisé et le rejet de l’Autre, est une attaque de plus envers les libertés individuelles et envers les familles. C’est pour ces raisons que nous vous demandons d’abandonner cette proposition de loi. *Les méthodes d’instruction doivent rester libres*, qu’elles soient l’œuvre des familles, des écoles privées hors contrats ou de l’école de la République.
Cordialement.
Co-auteurs et signataires :
[...]
[1] http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3704.asp
[2] http://ocw.mit.edu/index.htm
[3] https://www.edx.org/school/harvardx
[4] https://secure.avaaz.org/fr/petition/Au_gouvernement_francais_dans_son_ensemble_CONTRE_LA_PROPOSITION_DE_LOI_Ndeg_3704_du_27_avril_2016/
[5] http://www.citizengo.org/fr/34390-retrait-proposition-loi-visant-supprimer-lecole-maison
[6] http://www.senat.fr/leg/ppl13-245.html »
Sur un plan personnel, je note que cette proposition de loi s'attelle à résoudre un soi-disant problème qui concerne, selon l'exposé des motifs lui-même « 18 818 enfants étaient instruits à domicile, dont 5 063 en dehors d’une inscription réglementée au Centre national d’enseignement à distance (Cned) ». Donc oui, des parlementaires peuvent, du jour au lendemain, sans fumée, venir emmerder 0,03 % de la population du pays qui n'a rien demandée.
Cela me conforte dans ma vision qu'il ne suffit pas de « make », de faire dans son coin, de monter et faire vivre des alternatives. Il faut aussi mettre votre sujet sur la table publique, le documenter (pour qu'il soit reproduit s'il plaît et amélioré) et utiliser votre alternative comme preuve que vos idées sont applicables en vrai. Il faut aller râler auprès de nos représentant-e-s élu-e-s car c'est comme ça qu'est câblé notre pays et que, même si l'on refuse leur existence en mode anar, on ne pourra pas glisser vers un monde différent, un monde dans lequel une majorité se reconnaît, sans eux-elles. Il faut faire tout ça. Il faut empêcher les nuisibles de nuire. Il faut make et il faut attaquer. C'est fondamental. Je me suis déjà exprimé en long/large/travers sur ce sujet, voir : http://shaarli.guiguishow.info/?xo1oaQ .
-
Face à la prise en otage du monde, hackons nos existences : Reflets
« L’indignation est une forme de reconnaissance du pouvoir établi. S’indigner ne mène nulle part, et n‘a aucune chance d’améliorer quoi que ce soit sur la planète, au contraire. Plus les individus s’indignent, plus leur énergie est détournée de l’action concrète, de la fabrication, de la construction. [...] Résister, en s’indignant, en luttant, est le meilleur moyen d’être sous contrôle, de démontrer que le pouvoir est aux mains de ceux qui prétendent le détenir. Dans un monde ultra-technologique, pris dans les serres de puissances financières colossales, aux visages anonymes, la lutte est toujours écrasée, la résistance anéantie ou récupérée.Wed Jan 27 16:55:17 2016 - permalink - - https://reflets.info/face-a-la-prise-en-otage-du-monde-hackons-nos-existences/
[...]
Parler du libéralisme n’est pas parler de « libertés », mais d’une voie de gouvernance et au delà, d’une forme de philosophie de la vie, de « gestion des existences ». La pensée néo-libérale a écrasé le monde, et réussi un tour de force, celui de changer les mentalités, pour au final, les gouverner. Le néo-libéralisme fonctionne uniquement parce que les populations pensent leurs propres existences en termes néo-libéraux. [...] Le culte de l’efficacité, de l’optimisation et du profit s’est répandu dans les esprits : chacun, ou presque est une petite entreprise néo-libérale qui essaye d’optimiser sa gestion quotidienne de la vie. On gère ses enfants. On améliore son quotidien. On optimise son temps de travail. On organise sa vie. On profite de ses temps libres…
[...]
Le seul pouvoir réel des individus qui veulent un autre monde, plus juste, moins violent, plus harmonieux, plus apaisé, plus équilibré, etc, est celui de créer ce monde à leur propre échelle. Cette possibilité de reprendre le pouvoir n’est pas une simple vue de l’esprit, elle est parfaitement concrète. Mais elle demande de modifier profondément notre rapport au dit monde, et à notre existence.
[...]
Hacker nos existences signifie donc faire autrement dans une société qui ne fonctionne que d’une seule manière, celle du « libéralisme » appliqué à tous.
[...]
Il est ainsi possible, à sa propre échelle individuelle, au départ, d’exister autrement dans la société. Se ré-emparer de l’énergie, de son habitation, de l’éducation (surtout de la relation à ses enfants), de se nourrir, de s’activer ou de ne pas s’activer, de réfléchir, de dormir, prendre du plaisir, vaquer, cultiver, se déplacer, échanger…
[...]
Ainsi, est-il possible de créer son propre réseau de communication et d’accès à Internet, d’ouvrir des lieux d’échanges, de savoirs, de savoirs-faire, de créer son énergie, son habitat, de produire sa nourriture, d’en produire à plusieurs : vivre, quoi… »
Je ne suis pas entièrement d'accord. Fabriquer un nouveau monde, passer du "dire" au "faire" est une nécessité, pour les raisons décrites. Mais il faut également s'indigner, s'énerver, gueuler, résister, lutter contre le Système.
Simplement parce que le Système ne vous laissera pas tranquille en train de faire autrement. Je prends un exemple simple : l'instruction en famille. Ça ne dérange personne, chaque individu étant libre d'y recourir ou non. Ce n'est pas une secte. Ceux et celles qui en bénéficient n'essayent pas d'imposer leur vision du monde. Pourtant, les politocards sont venus emmerder ces personnes (voir http://shaarli.guiguishow.info/?QGLM4Q ). Autre exemple : monter des FAI associatifs n'empêchera pas les exploitants de délégation de service public, des sociétés commerciales, de vous évincer de leurs réseaux fibres optiques. Allez-vous construire un nième réseau fibré dans votre ville ? N'est-ce pas en contradiction avec certains de vos principes/valeurs comme ne pas refaire un taff déjà fait, de ne pas gaspiller de thune, de réduire l'empreinte écologique ? Monter des FAI associatifs n'empêchera pas non plus un gouvernement de les déclarer illégaux du jour au lendemain ou soumis à une redevance inaccessible à une association. Soyez bien conscient-e-s de ça.
Pour prendre un exemple abstrait : construire des châteaux de sable sur la plage, dans votre coin, ne vous protégera pas des brutes qui se croient intelligentes à détruire les constructions d'autrui. Oui, vous pouvez reconstruire en boucle, dans votre coin mais vous devez aussi aller expliquer à la brute que ce qu'il fait n'est pas bien, résister en somme et, si ça ne fonctionne pas, passer à une offensive plus virulente. Attention : je ne dis pas d'aller engueuler préventivement toute personne qui vous semble être une brute, ça serait un délit de faciès et une inversion de la charge (une personne est innocente tant que pas coupable et tant qu'un acte n'a pas été commis, on ne se permet pas de le deviner).
Un autre aspect à bien percevoir, c'est que tourner le dos permet donc aux malfaisants de tout poil d'agir avec encore plus de facilité puisqu'il n'y a vraiment plus personne pour se mettre en travers de leur route. Ainsi, tourner le dos à un détournement de subventions publiques par une personne et/ou une association en se disant qu'on ferait plutôt mieux d'aller "make" dans notre coin est le meilleur moyen que ce gaspillage d'argent public empire et d'avoir du sang sur les mains (vous saviez qu'il y a détournement et vous n'avez rien fait pour empêcher cela alors qu'une subvention publique, c'est l'argent de tous et toutes donc tous et toutes peuvent vous demander des comptes car vous avez une responsabilité d'autant plus si vous avez des preuves écrites de ce détournement). Il n'est moralement pas acceptable de laisser faire sous prétexte qu'on fabrique une alternative dans notre coin.
Pour résumer : "make" sans lutter contre le Système est aussi stupide que lutter contre le Système sans "make" des alternatives : ces deux extrêmes sont voués à l'échec. Il faut les deux car c'est complémentaire.
ÉDIT DU 27/01/2016 À 21H05 : Par pure coïncidence, voici que je tombe sur un billet de blog de Benjamin Bayart qui explique très précisément ça (http://edgard.fdn.fr/blog/index.php?post/2016/01/26/Faire ) :
« Dans les deux cas, j'arrive à la même idée : il importe de faire notre monde, notre société, selon nos méthodes. Nous voulons le faire sans passer par la case business ? Alors ne passons pas par cette case-là. Parfois, pour faire notre monde, notre société, avec nos règles, il faut que nous passions du temps à empêcher les nuisibles de trop nuire. Il faut par exemple essayer d'atténuer, un peu, le mal que nos politiques peuvent faire au monde quand ils essayent à toute force de s'accrocher au pouvoir contre toute logique, contre tout bon sens. Quand ils privilégient leurs petits intérêts électoraux, en agitant les peurs pour monter dans les sondages, au lieu de privilégier l'intérêt général en cherchant à apaiser la société. Quand ils utilisent les prétextes les plus vils pour assouvir leur soif de pouvoir. Leur envie de contrôler une société qui est en train de leur glisser des mains.
Pourtant, ce qui compte c'est de faire notre monde. Selon nos règles. Malgré leurs bêtises. Tout est là.
Lutter pour réduire la nuisance de leurs bêtises, en essayant de faire rentrer un tout petit peu d'intérêt général dans leur champ de compréhension du monde qui vient, c'est bien, c'est dans le bon sens. Mais ce n'est pas la finalité. C'est un moyen de protéger le monde que nous voulons, et que nous faisons, sans eux, malgré eux.
Il ne faut pas perdre de vue la société que nous voulons. Nous ne voulons pas de la façon habituelle de faire des affaires et des logiciels et des ordinateurs, alors ne rentrons pas dans leur jeu. Bien sûr, quand on voudrait bosser à plein temps sur un projet d'intérêt général et qu'on ne peut pas, qu'on est obligé de vendre sa force de travail à des malfaiteurs à la place, c'est frustrant. Ça nous ralentit. Mais faire rentrer nos projets dans leur système, c'est tout perdre. Il vaut mieux ne perdre que 35 heures par semaine à gagner de l'argent pour mener nos actions utiles le reste du temps. Quitte à tout perdre, autant laisser tomber et ne rien coder, ne rien faire.
De mon point de vue, il y a deux sortes de choses utiles : réduire les nuisances sans renoncer à ce que nous faisons, d'une part. Et faire le monde que nous voulons, d'autre part. » FIN DE L'ÉDIT.
-
Instruction obligatoire - Sénat - Johndescs's mini-recording
Putain ! FUCK YEAH ! Encore une belle victoire de la démocratie ! La proposition de loi qui visait à supprimer (enfin « limiter » dans le texte mais quand on limite autant, j'appelle ça supprimer) l'instruction en famille (aka "l'école à la maison", expression que je trouve impropre).Tue Mar 11 16:52:54 2014 - permalink - - http://jonathan.michalon.eu/shaarli/?u5O8ng
Bien joué à tous ceux qui ont participé à ce débat. Ne croyez pas que les sénateurs ont pris conscience tous seuls de la stupidité et du mal-fondé de leur proposition de loi. Ne croyez pas qu'ils ont eu peur d'un éventuel mur lors de la première lecture en séance plénière. Ne croyez surtout pas ça ! C'est bel et bien notre action collective (diffusion de l'information, mails, grogne auprès de la rapporteuse et, dans une bien moindre mesure, la pétition https://secure.avaaz.org/fr/petition/SENAT_Lannulation_de_la_proposition_de_loi_visant_a_limiter_le_droit_de_lief/, etc ...) qui a contribué à ce revirement et qui le justifie.
Oui, c'est chiant d'écrire des mails à ces gens là (sénateurs, députés, députés européens, présidence d'un conseil régional, ...), oui, ce n'est pas amusant, oui, c'est chronophage mais chacun de nous DOIT le faire ! Ce n'est pas insurmontable ! La préservation de nos libertés est à ce prix ! Face à nous, les lobbys, quels qu'ils soient, ont du temps à revendre (c'est leur job) et c'est ce qui fait leur puissance. N'oubliez pas que même si nos représentants semblent ignorer votre mail, votre appel téléphonique et vous font ressentir leur ennui lors d'une discussion face à face (si si, j'ai connu tout ça), votre action participe au bruit général qui les réveillera "ho, ça gronde sur ce texte, d'habitude ça gronde pas, il faut que je me bouge et que je prenne une position non idiote sur ce texte".
La démocratie, ce n'est pas juste élire des représentants et ne plus rien avoir à foutre de ce qui se passe au niveau politique (au sens « vie de la cité ») jusqu'aux prochaines élections, c'est avant tout une vigilance de tous les instants et un rétrocontrôle sur nos élus pour vérifier que le taff qui est fait en notre nom est bien fait et correspond à nos désirs.
Ne jamais croire que "c'est pas grave, j'ai la flemme, d'autres gens réagiront à ma place". Même si d'autres personnes se bougent, ce qui n'est déjà pas sûr au départ d'un combat, vous serez une voi(e|x) de plus et ça, ça peut tout changer. De plus, vous exposerez peut-être des arguments encore inédits dans la discussion et/ou vous la ferez progresser. Et n'oubliez pas : http://le-myosotis-province-aquitaine.over-blog.com/article-ne-rien-voir-ne-rien-dire-ne-rien-entendre-45209473.html . VOUS ÊTES PRÉCIEUX !
J'ose espérer que le retrait de cette proposition de loi n'est pas un stratagème politique en vue des prochaines élections et que cette proposition de loi ne ressurgira pas dans quelques mois ...
Maintenant que ce mini-dossier franco-français est clôt, nous pouvons nous consacrer à nouveau à la défense de la neutralité des réseaux en Europe (http://www.laquadrature.net/fr/les-negociations-au-parlement-europeen-sur-la-neutralite-du-net-prennent-un-tournant-desastreux). Il faudra ensuite s'attaquer à la réforme du droit d'auteur en Europe quand le prochain round s'ouvrira (round précédent au cas où : https://www.laquadrature.net/wiki/Consultation_Commission_Europ%C3%A9enne_2014). N'oubliez pas : vous avez du pouvoir, vous avez l'obligation d'agir, vous êtes précieux.
Petit historique basé sur ma perception des choses :
- Le 25 janvier 2014, j'apprends, par Johndescs, l'existence de cette proposition de loi. Même si je n'ai pas bénéficié de l'instruction en famille, ça me choque. Il s'agit d'une atteinte franche et brutale à une liberté qui est même inscrite à l'article 26-3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Et si j'avais voulu profiter de l'instruction en famille ? Et si je souhaite que mes éventuels enfants puissent en profiter ? Et si je souhaite que le fils du voisin de mon dentiste en profite ? Bref, vous avez compris. http://le-myosotis-province-aquitaine.over-blog.com/article-ne-rien-voir-ne-rien-dire-ne-rien-entendre-45209473.html again.
- Le 26 janvier 2014, nous sommes un petit groupe de citoyens d'horizons divers à écrire un mail commun aux sénateurs à l'origine de cette proposition de loi pour leur exposer nos arguments et expliquer notre mécontentement mais surtout, notre incompréhension. De plus, chacun d'entre nous envoie un mail personnel à son député.
- Le 4 février 2014, nous recevons un communiqué de presse pour toute réponse de la part du sénateur Hugues Portelli. Des citoyens assimilés à la presse ! Sérieusement ! On voit, une fois de plus, que nos représentants sont totalement à côté de la plaque ! Le contenu est sans intérêt puisqu'il ne fait que reprendre les arguments fallacieux, basés sur aucun fait, déjà exposés dans la proposition de loi. Notre interlocuteur n'a clairement pas lu notre mail. Allez, je passe l'éponge sur le fait d'envoyer ledit communiqué au format docx en PJ d'un mail ... Pourquoi utiliser un format texte qui passe partout quand on peut utiliser un format propriétaire, hein, franchement ? C'est stupide ! ;)
- Le 6 février 2014, nous répondons à Hugues Portelli. Nous insistons sur le fait que nous n'apprécions pas d'être pris pour autre chose que les citoyens que nous sommes ni le fait que le contenu de notre mail ait été ignoré. On renouvelle notre argumentaire, on oriente notre réponse en fonction du communiqué de notre interlocuteur et on envoie.
- Le 18 février 2014, Jacques Gautier, un des cosignataires, se retire de cette proposition de loi. Esther Sittler s'est aussi retirée de cette proposition de loi mais je n'ai pas connaissance de la date.
- Le 28 février 2014, c'est Louis Pinton, un des cosignataires, qui nous répond pour soutenir Hugues Portelli. À nouveau, la réponse joue sur les peurs et consacre l'école de la République comme étant le « lieu irremplaçable de scolarisation ». Le sénateur n'ayant pas utilisé CCi mais juste To, nous prenons conscience que nous ne sommes vraiment pas les seuls à avoir réagi. Il y a une 50aine d'adresses mail. Et je suis sûr qu'il en manque encore une grande partie en fonction de la date d'arrivée du mail, ceux envoyés aux autres sénateurs cosignataires, ceux envoyés aux députés, ... Rien qu'au sein de notre tout petit groupe de personnes, des adresses ont été oubliées par le sénateur. C'est dans ces magnifiques moments que l'on reprend confiance en l'humanité : nos représentants font n'importe quoi mais il y a encore des gens qui réfléchissent et qui agissent. Les jours suivants (jusqu'au 03/03/2014), c'est une déferlante de mails destinés à Louis Pinton que nous recevons puisque nous sommes (volontairement cette fois-ci), en Cc. Des mails de citoyens de toute la France et de tous les horizons.
- Le 9 mars 2014, l'un d'entre nous répond une dernière fois. Tout a déjà été dit, tous les points de vue se sont confrontés, améliorés, ... lors de la tornade des jours précédents évoquée au tiret précédent.
- Le 11 mars 2014, lors de la première lecture en séance plénière, l'auteur retire cette proposition de loi. Aucun sénateur ne reprend la discussion donc la proposition de loi est abandonnée (article 84 du Règlement applicable aux deux chambres : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp#P1067_119961). J'attends le compte rendu analytique (http://www.senat.fr/seances/comptes-rendus.html) pour voir ce qu'il s'est passé exactement.
Sur un plan plus personnel, je note :
- Que nous n'avons eu aucune réponse des députés ... Ce n'est pas la première fois que j'ai une absence totale de réponse des députés que je contacte. Bon, cette fois-ci, ils ont une "excuse" facile : le texte n'est pas arrivé jusqu'à l'Assemblée.
- Nos représentants ne savent toujours pas faire la différence entre un simple citoyen ou un groupe de citoyens qui les contacte et la presse, ce qui amène des réponses totalement déplacées sans aucun fond sur lequel discuter. C'est fort dommage.
- Le logiciel libre dans la représentation nationale, ce n'est pas encore ça ... Mais ce n'est pas un scoop : http://www.pcinpact.com/news/71622-assemblee-nationale-ubuntu-windows-briand.htm . Ça pose de véritables problèmes en terme d'accessibilité au plus grand nombre, d'indépendance, ...
- Nos représentants ne savent toujours pas utiliser les fonctions « Répondre à tous » et « Cci » de leur MUA.
-
Hop ! Une liberté de moins… | Jonathan.Michalon.eu
« … et ce qui devait arriver arriva : non content d'obliger la grande majorité des gens à rentrer dans le moule de l'Éducation Nationale, le gouvernement vise maintenant les quelques-uns qui s'efforçaient d'y échapper. En effet, un projet de loi proposant la quasi-suppression de l'instruction en famille (IEF) est actuellement étudié. http://www.senat.fr/leg/ppl13-245.html »Sun Jan 26 00:34:22 2014 - permalink - - http://jonathan.michalon.eu/hop-une-liberte-de-moins.html
ÉDIT du 11 mars 2014 à 20h30 : proposition de loi finalement abandonnée. Voir : http://shaarli.guiguishow.info/?QGLM4Q
